-
 Le numéro 3 d’Horizons Hémato nous propose de faire un tour d’horizon complet sur la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC), la leucémie la plus fréquente des pays de l’Ouest (4000 nouveaux cas incidents en France en 2011). Le « Grand angle », de ce fait, aborde la pathologie sous ses multiples facettes, allant des aspects parfois méconnus épidémiologiques ou plus fondamentaux à une prise en charge thérapeutique adaptée à chaque patient, sans oublier les nombreux aspects novateurs (drogues de mieux en mieux ciblées) permettant à l’ensemble de la collectivité médicale scientifique et à tous nos patients de nourrir des espoirs de guérison chez les sujets jeunes ou d’amélioration de la qualité de vie chez les patients plus âgés présentant parfois des comorbidités. Les groupes scientifiques doivent promouvoir l’amélioration des connaissances de la maladie. La mise en place récente de l’Intergroupe illustre notre volonté affirmée de mutualiser l’ensemble de nos compétences et de nos moyens. Le dynamisme de ce groupe représenté par notre présidente Véronique Leblond et nos présidents du Conseil Scientifique, Alain Delmer et Pierre Feugier, permet la mise en place sur tout le territoire de nombreux essais cliniques nationaux voire internationaux. Les projets multiples portés et soutenus par l’association des patients SILLC, en coordination avec nos tutelles institutionnelles et scientifiques, illustrent aussi la place prédominante que nous accordons tous aux patients. Enfin, les publications scientifiques consacrées à la LLC et indexées dans PubMed (une seule en 1949 et 872 en 2011) illustrent l’intérêt croissant de la collectivité médicale à cette hémopathie maligne. Nous sommes aussi fiers que la France soit dans le top 5 des publications. Je remercie l’ensemble des auteurs, qui ont fait preuve d’une grande pédagogie et qui ont tous contribué à la réussite de ce numéro de très grande qualité. Tous les aspects de la maladie ont été regardés et traités avec beaucoup d’attention, même si certains aspects, en particulier le point de vue de l’infirmière ont été omis uniquement pour des raisons organisationnelles. La mise en place d’un Fond de dotation « Force Hémato » nous permettra de développer et structurer la recherche clinique et fondamentale et de mettre en place de façon organisée des thèques. La LLC, nous l’espérons, sera reconnue comme une grande cause nationale dans les prochaines années. Pr Xavier Troussard Hématologie, CHU Côte de Nacre, Caen Coordinateur du Grand Angle
Le numéro 3 d’Horizons Hémato nous propose de faire un tour d’horizon complet sur la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC), la leucémie la plus fréquente des pays de l’Ouest (4000 nouveaux cas incidents en France en 2011). Le « Grand angle », de ce fait, aborde la pathologie sous ses multiples facettes, allant des aspects parfois méconnus épidémiologiques ou plus fondamentaux à une prise en charge thérapeutique adaptée à chaque patient, sans oublier les nombreux aspects novateurs (drogues de mieux en mieux ciblées) permettant à l’ensemble de la collectivité médicale scientifique et à tous nos patients de nourrir des espoirs de guérison chez les sujets jeunes ou d’amélioration de la qualité de vie chez les patients plus âgés présentant parfois des comorbidités. Les groupes scientifiques doivent promouvoir l’amélioration des connaissances de la maladie. La mise en place récente de l’Intergroupe illustre notre volonté affirmée de mutualiser l’ensemble de nos compétences et de nos moyens. Le dynamisme de ce groupe représenté par notre présidente Véronique Leblond et nos présidents du Conseil Scientifique, Alain Delmer et Pierre Feugier, permet la mise en place sur tout le territoire de nombreux essais cliniques nationaux voire internationaux. Les projets multiples portés et soutenus par l’association des patients SILLC, en coordination avec nos tutelles institutionnelles et scientifiques, illustrent aussi la place prédominante que nous accordons tous aux patients. Enfin, les publications scientifiques consacrées à la LLC et indexées dans PubMed (une seule en 1949 et 872 en 2011) illustrent l’intérêt croissant de la collectivité médicale à cette hémopathie maligne. Nous sommes aussi fiers que la France soit dans le top 5 des publications. Je remercie l’ensemble des auteurs, qui ont fait preuve d’une grande pédagogie et qui ont tous contribué à la réussite de ce numéro de très grande qualité. Tous les aspects de la maladie ont été regardés et traités avec beaucoup d’attention, même si certains aspects, en particulier le point de vue de l’infirmière ont été omis uniquement pour des raisons organisationnelles. La mise en place d’un Fond de dotation « Force Hémato » nous permettra de développer et structurer la recherche clinique et fondamentale et de mettre en place de façon organisée des thèques. La LLC, nous l’espérons, sera reconnue comme une grande cause nationale dans les prochaines années. Pr Xavier Troussard Hématologie, CHU Côte de Nacre, Caen Coordinateur du Grand Angle -
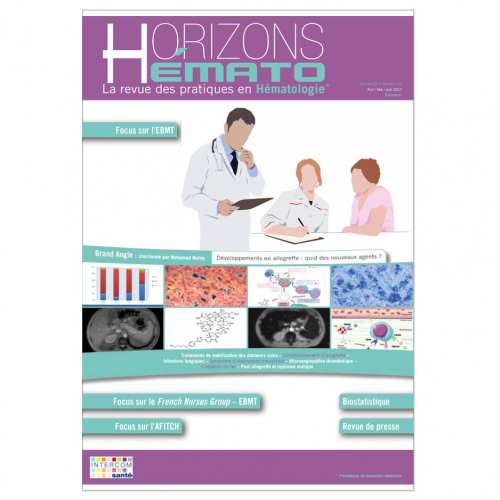 L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est un traitement qui est actuellement en pleine expansion tant sur le plan national qu’international. Cette augmentation significative de l’activité au décours des dix dernières années est liée essentiellement à l’introduction des conditionnements dits à intensité ou toxicité réduite qui ont permis l’accès à l’allogreffe à des patients de plus en plus âgés, mais également à des patients ayant des comorbidités qui, jusque-là, étaient considérées comme des contre-indications à l’allogreffe. Une autre raison à l’augmentation de cette activité est celle de l’utilisation de donneurs de cellules souches dits alternatifs comme les donneurs volontaires HLA identiques ou encore les donneurs dits haplo identiques, et les sangs de cordons. Malgré le traitement de patients de plus en plus lourds et des pathologies de plus en plus de haut risque, la toxicité liée à la greffe, du moins dans les premiers temps post-allogreffe, a été également nettement diminuée au cours des dix dernières années. Une grande part de cette diminution des toxicités est liée à la mise au point de protocoles de traitements de support de plus en plus efficaces, mais aussi à l’utilisation d’agents thérapeutiques dont le profil de toxicité est très favorable. Ce numéro de la revue Horizons Hémato consacre un dossier visant à faire le point sur l’état actuel et les développements attendus grâce à l’utilisation de nouveaux agents thérapeutiques dont un grand nombre est déjà utilisé en dehors du contexte de l’allogreffe. Les différents articles ont été élaborés avec un grand soin par des spécialistes confirmés dans leur domaine, mais également grâce à des collègues plus jeunes qui ont fourni un effort remarquable de synthèse. Les différents thèmes abordés dans ce « Grand Angle » permettront certainement de fournir aux investigateurs impliqués dans ce domaine des informations précises pour mieux comprendre les enjeux et donc d’identifier les besoins et les domaines de recherche à développer. Bonne lecture, Pr. Mohamad MOHTY
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est un traitement qui est actuellement en pleine expansion tant sur le plan national qu’international. Cette augmentation significative de l’activité au décours des dix dernières années est liée essentiellement à l’introduction des conditionnements dits à intensité ou toxicité réduite qui ont permis l’accès à l’allogreffe à des patients de plus en plus âgés, mais également à des patients ayant des comorbidités qui, jusque-là, étaient considérées comme des contre-indications à l’allogreffe. Une autre raison à l’augmentation de cette activité est celle de l’utilisation de donneurs de cellules souches dits alternatifs comme les donneurs volontaires HLA identiques ou encore les donneurs dits haplo identiques, et les sangs de cordons. Malgré le traitement de patients de plus en plus lourds et des pathologies de plus en plus de haut risque, la toxicité liée à la greffe, du moins dans les premiers temps post-allogreffe, a été également nettement diminuée au cours des dix dernières années. Une grande part de cette diminution des toxicités est liée à la mise au point de protocoles de traitements de support de plus en plus efficaces, mais aussi à l’utilisation d’agents thérapeutiques dont le profil de toxicité est très favorable. Ce numéro de la revue Horizons Hémato consacre un dossier visant à faire le point sur l’état actuel et les développements attendus grâce à l’utilisation de nouveaux agents thérapeutiques dont un grand nombre est déjà utilisé en dehors du contexte de l’allogreffe. Les différents articles ont été élaborés avec un grand soin par des spécialistes confirmés dans leur domaine, mais également grâce à des collègues plus jeunes qui ont fourni un effort remarquable de synthèse. Les différents thèmes abordés dans ce « Grand Angle » permettront certainement de fournir aux investigateurs impliqués dans ce domaine des informations précises pour mieux comprendre les enjeux et donc d’identifier les besoins et les domaines de recherche à développer. Bonne lecture, Pr. Mohamad MOHTY -
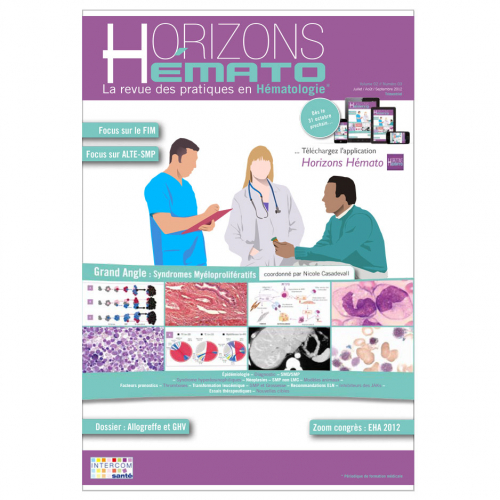 C’est en 1951 que, William Dameshek, émet l’hypothèse essentielle (TE) et la myélofibrose primaire (MFP) sont des hémopathies étroitement apparentées avec à leur origine un stimulus commun. À l'origine appelées syndromes myéloprolifératifs (SMP), elles ont été renommées néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) mais cette terminologie n'est pas adaptée à la modélisation et aux formes familiales. Pour ces raisons, cette nomenclature n'est pas adoptée de façon universelle. La description en 2005 de la mutation activatrice V617F du gène codant pour JAK2 (Janus Kinase 2), une tyrosine kinase impliquée dans la signalisation de nombreux récepteurs de cytokines dont ceux de l’érythropoïétine de la thrombopoïétine et des cytokines de la lignée granuleuse, a fourni une explication aux similitudes cliniques et évolutives de ces 3 hémopathies. En effet au moins 95 % des PV, 50 à 60 % des TE et des MFP présentent la mutation V617F. D’autres mutations plus rares ont été décrites et toutes induisent une dérégulation du signal induit par les récepteurs aux cytokines avec une activation constitutive de JAK2 et un rôle important de l’activation des STAT, dont STAT5, dans leur pathogénie. Cependant il reste à démontrer que ceci est également vrai dans les TE et les MFP sans mutation de signalisation identifiée. Cette découverte a ouvert le champ à une recherche très active, aussi bien fondamentale que clinique. Une première conséquence a été en 2008 la modification des algorithmes diagnostiques recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’intégration de la mutation V617F de JAK2 dans les critères majeurs. Un autre aspect encore incomplètement compris est comment une mutation unique (V617F) peut donner trois pathologies différentes. Il existe trois grandes hypothèses qui ne sont pas antinomiques. Dans la première c’est le niveau de signalisation voire son type qui définit la maladie. L’un des déterminants majeurs est la présence ou non d’un clone homozygote survenu à la suite d’une recombinaison mitotique du clone hétérozygote et qui entraîne une dominance clonale. Cet aspect du point de vue pratique se traduit par la charge allélique plus forte dans les MF secondaires que dans les PV et plus forte dans les PV que dans les TE. La seconde hypothèse souligne l’importancede déterminants génétiques constitutionnels qui vont intervenir dans la signalisation de V617F. Enfin ces dernières années de nombreux arguments ont été apportés en faveur de l’existence d’autres mutations acquises portant soit sur des régulateurs de l’épigénétique, soit sur des gènes impliqués dans l’épissage qui seraient responsables de l’hétérogénéité des néoplasmes myéloprolifératifs. Ceci est particulièrement bien démontré dans les myélofibroses primaires, mais beaucoup moins évident dans les PV, les TE et les myélofibroses secondaires. La découverte de ces nombreuses autres mutations non impliquées dans la signalisation a mis en évidence une plus grande complexité dans la physiopathologie des NPM qu’attendue et en font des maladies beaucoup plus complexes que la LMC. Surtout ces données font que la théorie initiale de W. Dameshek ne représente qu’une partie de la réalité et que les NPM doivent être plus vus comme une continuité avec les autres hémopathies malignes comme les SMP/SMD, les SMD voire les LAM. Cette continuité en fait donc des maladies particulièrement attractives pour comprendre l’oncogenèse des hémopathies malignes et également pour développer de nouveaux traitements. Ces cinq dernières années ont vu des changements thérapeutiques profonds basés sur l’utilisation de l’Interféron-alpha et sur des inhibiteurs de JAK2. On peut penser que ces nouvelles approches thérapeutiques n’en sont qu’à leur début et évolueront lorsqu’on progressera à la fois dans la compréhension des modifications engendrées dans la structure de JAK2 par les mutations et dans le rôle des autres mutations dans la physiopathologie de ces maladies. Nous avons essayé, dans ce numéro d’Horizons Hémato consacré aux SMP, d’aller des aspects fondamentaux à la pratique. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la rédaction de ces articles très riches et nous espérons que les lecteurs prendront conscience du vaste champ de recherche qui s’ouvre dans ces pathologies Ce numéro de la revue coïncide avec le lancement de l’application Horizons Hémato. L’ampleur des informations apportées par la totalité des articles va permettre une publication papier synthétique, enrichie par les divers compléments postés sur l’application. Nous vous souhaitons une très bonne lecture, Nicole CASADEVALL Coordinatrice du dossier SMP nicole.casadevall@sat.aphp.fr William VAINCHENKER Président du conseil scientifique du FIM verpre@igr.fr
C’est en 1951 que, William Dameshek, émet l’hypothèse essentielle (TE) et la myélofibrose primaire (MFP) sont des hémopathies étroitement apparentées avec à leur origine un stimulus commun. À l'origine appelées syndromes myéloprolifératifs (SMP), elles ont été renommées néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) mais cette terminologie n'est pas adaptée à la modélisation et aux formes familiales. Pour ces raisons, cette nomenclature n'est pas adoptée de façon universelle. La description en 2005 de la mutation activatrice V617F du gène codant pour JAK2 (Janus Kinase 2), une tyrosine kinase impliquée dans la signalisation de nombreux récepteurs de cytokines dont ceux de l’érythropoïétine de la thrombopoïétine et des cytokines de la lignée granuleuse, a fourni une explication aux similitudes cliniques et évolutives de ces 3 hémopathies. En effet au moins 95 % des PV, 50 à 60 % des TE et des MFP présentent la mutation V617F. D’autres mutations plus rares ont été décrites et toutes induisent une dérégulation du signal induit par les récepteurs aux cytokines avec une activation constitutive de JAK2 et un rôle important de l’activation des STAT, dont STAT5, dans leur pathogénie. Cependant il reste à démontrer que ceci est également vrai dans les TE et les MFP sans mutation de signalisation identifiée. Cette découverte a ouvert le champ à une recherche très active, aussi bien fondamentale que clinique. Une première conséquence a été en 2008 la modification des algorithmes diagnostiques recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’intégration de la mutation V617F de JAK2 dans les critères majeurs. Un autre aspect encore incomplètement compris est comment une mutation unique (V617F) peut donner trois pathologies différentes. Il existe trois grandes hypothèses qui ne sont pas antinomiques. Dans la première c’est le niveau de signalisation voire son type qui définit la maladie. L’un des déterminants majeurs est la présence ou non d’un clone homozygote survenu à la suite d’une recombinaison mitotique du clone hétérozygote et qui entraîne une dominance clonale. Cet aspect du point de vue pratique se traduit par la charge allélique plus forte dans les MF secondaires que dans les PV et plus forte dans les PV que dans les TE. La seconde hypothèse souligne l’importancede déterminants génétiques constitutionnels qui vont intervenir dans la signalisation de V617F. Enfin ces dernières années de nombreux arguments ont été apportés en faveur de l’existence d’autres mutations acquises portant soit sur des régulateurs de l’épigénétique, soit sur des gènes impliqués dans l’épissage qui seraient responsables de l’hétérogénéité des néoplasmes myéloprolifératifs. Ceci est particulièrement bien démontré dans les myélofibroses primaires, mais beaucoup moins évident dans les PV, les TE et les myélofibroses secondaires. La découverte de ces nombreuses autres mutations non impliquées dans la signalisation a mis en évidence une plus grande complexité dans la physiopathologie des NPM qu’attendue et en font des maladies beaucoup plus complexes que la LMC. Surtout ces données font que la théorie initiale de W. Dameshek ne représente qu’une partie de la réalité et que les NPM doivent être plus vus comme une continuité avec les autres hémopathies malignes comme les SMP/SMD, les SMD voire les LAM. Cette continuité en fait donc des maladies particulièrement attractives pour comprendre l’oncogenèse des hémopathies malignes et également pour développer de nouveaux traitements. Ces cinq dernières années ont vu des changements thérapeutiques profonds basés sur l’utilisation de l’Interféron-alpha et sur des inhibiteurs de JAK2. On peut penser que ces nouvelles approches thérapeutiques n’en sont qu’à leur début et évolueront lorsqu’on progressera à la fois dans la compréhension des modifications engendrées dans la structure de JAK2 par les mutations et dans le rôle des autres mutations dans la physiopathologie de ces maladies. Nous avons essayé, dans ce numéro d’Horizons Hémato consacré aux SMP, d’aller des aspects fondamentaux à la pratique. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la rédaction de ces articles très riches et nous espérons que les lecteurs prendront conscience du vaste champ de recherche qui s’ouvre dans ces pathologies Ce numéro de la revue coïncide avec le lancement de l’application Horizons Hémato. L’ampleur des informations apportées par la totalité des articles va permettre une publication papier synthétique, enrichie par les divers compléments postés sur l’application. Nous vous souhaitons une très bonne lecture, Nicole CASADEVALL Coordinatrice du dossier SMP nicole.casadevall@sat.aphp.fr William VAINCHENKER Président du conseil scientifique du FIM verpre@igr.fr -
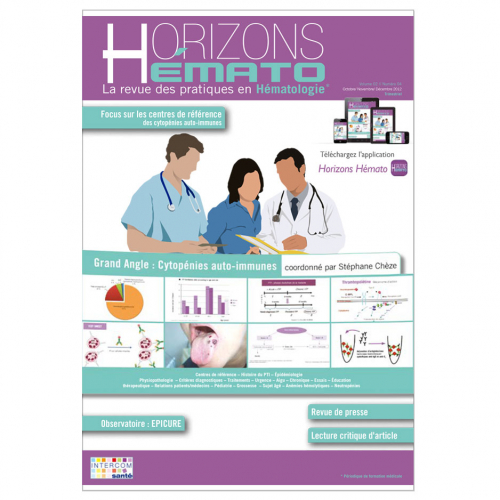 Longtemps considéré comme une pathologie orpheline bénigne dont le traitement reposait essentiellement sur les corticoïdes et la splénectomie, le purpura thrombopénique immunologique (PTI) a bénéficié au cours des dix dernières années d’innovations thérapeutiques réelles. Une meilleure compréhension de sa physiopathologie a permis le développement de nouvelles stratégies de prise en charge basées sur une stimulation de la production des plaquettes par les agents thrombopoïétiques et sur la modulation de la réponse immunitaire, en particulier des lymphocytes B, grâce à l’utilisation d’anticorps monoclonaux. Ces dernières années ont également été marquées par une meilleure connaissance de l’épidémiologie et par la prise en compte du retentissement indéniable de la maladie sur la qualité de vie. Ces progrès ont paradoxalement rendu la prise en charge du PTI plus complexe ; il n’existe pas une stratégie consensuelle et univoque car la multiplication des possibilités thérapeutiques rend plus que jamais nécessaire une personnalisation des choix thérapeutiques et un accompagnement du patient en développant des actions d’éducation thérapeutique. Ce numéro d’Horizons Hémato a pour ambition d’aider les cliniciens dans la prise en charge de cette pathologie. En faisant appel à des spécialistes reconnus, y compris pour les aspects pédiatriques de la maladie, dont la plupart appartiennent au réseau du centre de référence des cytopénies auto-immunes, nous espérons que cet objectif sera atteint. Il aurait été cependant dommage de limiter ce numéro à la prise en charge du PTI car même si elles sont beaucoup moins fréquentes, les neutropénies auto-immunes et les anémies hémolytiques auto-immunes sont des pathologies rares dont la prise en charge diagnostique et thérapeutique reste également difficile. Là encore, le recours à des experts reconnus dans ces deux domaines devrait répondre aux attentes des lecteurs. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont accepté avec enthousiasme de participer à la rédaction de ce numéro de la revue qui est maintenant aussi disponible sur l’application Horizons Hémato pour iOS (iPhone et iPad) et Android.Cette version électronique complète la publication papier synthétique ; elle est enrichie par les divers compléments proposés par les auteurs. Bonne lecture, Bertrand GODEAU Coordonnateur du centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte bertrand.godeau@hmn.aphp.fr Stéphane CHÈZE Coordinateur du Grand Angle « cytopénies auto-immunes » cheze-s@chu-caen.fr
Longtemps considéré comme une pathologie orpheline bénigne dont le traitement reposait essentiellement sur les corticoïdes et la splénectomie, le purpura thrombopénique immunologique (PTI) a bénéficié au cours des dix dernières années d’innovations thérapeutiques réelles. Une meilleure compréhension de sa physiopathologie a permis le développement de nouvelles stratégies de prise en charge basées sur une stimulation de la production des plaquettes par les agents thrombopoïétiques et sur la modulation de la réponse immunitaire, en particulier des lymphocytes B, grâce à l’utilisation d’anticorps monoclonaux. Ces dernières années ont également été marquées par une meilleure connaissance de l’épidémiologie et par la prise en compte du retentissement indéniable de la maladie sur la qualité de vie. Ces progrès ont paradoxalement rendu la prise en charge du PTI plus complexe ; il n’existe pas une stratégie consensuelle et univoque car la multiplication des possibilités thérapeutiques rend plus que jamais nécessaire une personnalisation des choix thérapeutiques et un accompagnement du patient en développant des actions d’éducation thérapeutique. Ce numéro d’Horizons Hémato a pour ambition d’aider les cliniciens dans la prise en charge de cette pathologie. En faisant appel à des spécialistes reconnus, y compris pour les aspects pédiatriques de la maladie, dont la plupart appartiennent au réseau du centre de référence des cytopénies auto-immunes, nous espérons que cet objectif sera atteint. Il aurait été cependant dommage de limiter ce numéro à la prise en charge du PTI car même si elles sont beaucoup moins fréquentes, les neutropénies auto-immunes et les anémies hémolytiques auto-immunes sont des pathologies rares dont la prise en charge diagnostique et thérapeutique reste également difficile. Là encore, le recours à des experts reconnus dans ces deux domaines devrait répondre aux attentes des lecteurs. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont accepté avec enthousiasme de participer à la rédaction de ce numéro de la revue qui est maintenant aussi disponible sur l’application Horizons Hémato pour iOS (iPhone et iPad) et Android.Cette version électronique complète la publication papier synthétique ; elle est enrichie par les divers compléments proposés par les auteurs. Bonne lecture, Bertrand GODEAU Coordonnateur du centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte bertrand.godeau@hmn.aphp.fr Stéphane CHÈZE Coordinateur du Grand Angle « cytopénies auto-immunes » cheze-s@chu-caen.fr -
 Dans ce second volet consacré à la pathologie érythrocytaire notre « Grand Angle » se focalise sur la prise en charge actuelle des surcharges martiales et de la drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente sur le territoire français. Les syndromes thalassémiques sont abordés sous l’angle novateur de la thérapie génique, rappelant que la recherche dans ce domaine constitue une source majeure d’espoir pour les patients. La rubrique biologie quant à elle nous éclaire sur l’apport des techniques de cytogénétique moléculaire (CGH-array, SNP-array) appliquées au diagnostic des hémopathies malignes. La rédaction d’Horizons Hémato tient à remercier chaleureusement le Professeur Loïc Garçon ainsi que tous les éminents experts français ici réunis pour leur contribution à ce nouveau numéro. Bonne lecture ! Dr. Christophe Marzac. Rédacteur en chef-adjoint. Gustave Roussy, Villejuif.
Dans ce second volet consacré à la pathologie érythrocytaire notre « Grand Angle » se focalise sur la prise en charge actuelle des surcharges martiales et de la drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente sur le territoire français. Les syndromes thalassémiques sont abordés sous l’angle novateur de la thérapie génique, rappelant que la recherche dans ce domaine constitue une source majeure d’espoir pour les patients. La rubrique biologie quant à elle nous éclaire sur l’apport des techniques de cytogénétique moléculaire (CGH-array, SNP-array) appliquées au diagnostic des hémopathies malignes. La rédaction d’Horizons Hémato tient à remercier chaleureusement le Professeur Loïc Garçon ainsi que tous les éminents experts français ici réunis pour leur contribution à ce nouveau numéro. Bonne lecture ! Dr. Christophe Marzac. Rédacteur en chef-adjoint. Gustave Roussy, Villejuif. -
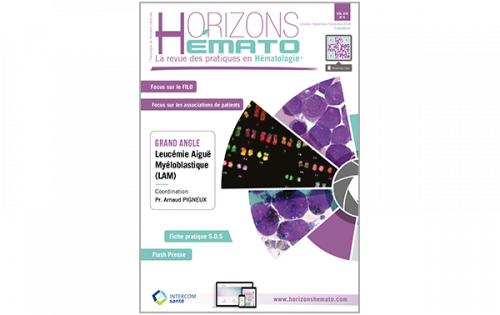 Pourquoi consacrer un « Grand Angle » à l’érythropoïèse et aux anémies carentielles ? Probablement parce que malgré les algorithmes décisionnels que l’on trouve à foison jusque dans nos salles d’attente, tout médecin draîne dans sa patientèle son cortège d’anémies inexpliquées ou ne répondant pas au traitement entrepris; probablement parce que certaines anémies mégaloblastiques ne sont pas ce que l’on croît, parce que l’anémie de l’insuffisance rénale n’est pas qu’un défaut de production d’érythropoïétine, parce que les liens étroits entre le métabolisme du fer, l’inflammation et la production de globules rouges n’ont jamais été aussi bien compris que depuis la découverte (française !) de l’hepcidine, probablement parce que le fameux traitement étiologique de l’anémie inflammatoire ou devrions-nous dire de l’hyperhepcidinémie chronique, n’a jamais été aussi proche de devenir réalité, probablement parce que peu de temps après avoir compris l’intérêt de doser la fraction soluble du récepteur de la transferrine, les biologistes vont devoir intégrer et accréditer comme il se doit le dosage de l’hepcidine, hormone responsable de la séquestration du fer dans les cellules, voire celui de l’érythroferrone qui, sécrétée par le proérythroblaste, établit enfin un lien tangible et dynamique entre l’érythropoïèse et le métabolisme martial. Cette compréhension des mécanismes de l’homéostasie du fer a apporté des éclairages sur les maladies comme l’hémochromatose primitive ou secondaire à des pathologies de l’érythropoïèse. Mais de nombreuses pathologies associées ou secondaires à des régulations anormales locales du métabolisme du fer sont en train d’émerger notamment en neurologie comme dans la maladie de Parkinson ou l’ataxie de Friedrich où les chélateurs du fer sont utilisés avec succès ou en cardiologie où le fer injectable est utilisé dans les insuffisances cardiaques. Plus nous avançons dans la compréhension de ces régulations complexes plus nous découvrons et découvrirons de nouveaux acteurs qui nous éclairent sur la physiologie et la physiopathologie des anémies mais aussi d’autres maladies et, nous l’espérons, nous apporterons de nouvelles cibles thérapeutiques. La découverte de l’EPO en est un exemple remarquable qui a apporté des éclairages importants à la fois sur la régulation de l’hypoxie et dont l’utilisation thérapeutique a révolutionné la prise en charge de l’anémie de l’insuffisance rénale et de certaines myélodysplasies. Plus récemment la découverte de l’effet de récepteurs solubles des membres de la famille du TGF-β (luspatercept et sotatercept) dans le traitement de l’érythropoïèse inefficace des thalassémies et de certaines myélodysplasies en est un exemple remarquable. L’érythropoïèse est sans doute le système associé à la plus grande prolifération cellulaire qui soit (2 millions de globules rouges fabriqués par seconde) mais aussi le plus finement régulé mais dont les précurseurs ont pour particularité originale d’utiliser le programme d’apoptose à la fois pour réguler leur mort mais aussi leur différenciation. Nul doute que la compréhension de ce système apportera aussi des éléments importants pour traiter le cancer mais aussi les maladies dégénératives. Dans ce dossier nous vous proposons d’opter pour une nouvelle lecture de l’érythropoïèse du métabolisme du fer à l’heure où de nouveaux concepts de thérapies ciblées voient le jour, de revisiter les diagnostics différentiels et la thérapeutique des anémies mégaloblastiques, sans oublier les nouvelles approches en médecine transfusionnelle. En espérant que cette thématique d’étude continuera à attirer les plus jeunes et que de nombreux secrets sont encore à découvrir ainsi que leurs applications dans différents champs de la médecine. La rédaction remercie chaleureusement les auteurs d’avoir su relever ce défi ! Dr Christophe MARZAC, Villejuif, christophe.marzac@gustaveroussy.fr Pr Olivier HERMINE, Paris, ohermine@aphp.com Coordinateurs du « Grand Angle »
Pourquoi consacrer un « Grand Angle » à l’érythropoïèse et aux anémies carentielles ? Probablement parce que malgré les algorithmes décisionnels que l’on trouve à foison jusque dans nos salles d’attente, tout médecin draîne dans sa patientèle son cortège d’anémies inexpliquées ou ne répondant pas au traitement entrepris; probablement parce que certaines anémies mégaloblastiques ne sont pas ce que l’on croît, parce que l’anémie de l’insuffisance rénale n’est pas qu’un défaut de production d’érythropoïétine, parce que les liens étroits entre le métabolisme du fer, l’inflammation et la production de globules rouges n’ont jamais été aussi bien compris que depuis la découverte (française !) de l’hepcidine, probablement parce que le fameux traitement étiologique de l’anémie inflammatoire ou devrions-nous dire de l’hyperhepcidinémie chronique, n’a jamais été aussi proche de devenir réalité, probablement parce que peu de temps après avoir compris l’intérêt de doser la fraction soluble du récepteur de la transferrine, les biologistes vont devoir intégrer et accréditer comme il se doit le dosage de l’hepcidine, hormone responsable de la séquestration du fer dans les cellules, voire celui de l’érythroferrone qui, sécrétée par le proérythroblaste, établit enfin un lien tangible et dynamique entre l’érythropoïèse et le métabolisme martial. Cette compréhension des mécanismes de l’homéostasie du fer a apporté des éclairages sur les maladies comme l’hémochromatose primitive ou secondaire à des pathologies de l’érythropoïèse. Mais de nombreuses pathologies associées ou secondaires à des régulations anormales locales du métabolisme du fer sont en train d’émerger notamment en neurologie comme dans la maladie de Parkinson ou l’ataxie de Friedrich où les chélateurs du fer sont utilisés avec succès ou en cardiologie où le fer injectable est utilisé dans les insuffisances cardiaques. Plus nous avançons dans la compréhension de ces régulations complexes plus nous découvrons et découvrirons de nouveaux acteurs qui nous éclairent sur la physiologie et la physiopathologie des anémies mais aussi d’autres maladies et, nous l’espérons, nous apporterons de nouvelles cibles thérapeutiques. La découverte de l’EPO en est un exemple remarquable qui a apporté des éclairages importants à la fois sur la régulation de l’hypoxie et dont l’utilisation thérapeutique a révolutionné la prise en charge de l’anémie de l’insuffisance rénale et de certaines myélodysplasies. Plus récemment la découverte de l’effet de récepteurs solubles des membres de la famille du TGF-β (luspatercept et sotatercept) dans le traitement de l’érythropoïèse inefficace des thalassémies et de certaines myélodysplasies en est un exemple remarquable. L’érythropoïèse est sans doute le système associé à la plus grande prolifération cellulaire qui soit (2 millions de globules rouges fabriqués par seconde) mais aussi le plus finement régulé mais dont les précurseurs ont pour particularité originale d’utiliser le programme d’apoptose à la fois pour réguler leur mort mais aussi leur différenciation. Nul doute que la compréhension de ce système apportera aussi des éléments importants pour traiter le cancer mais aussi les maladies dégénératives. Dans ce dossier nous vous proposons d’opter pour une nouvelle lecture de l’érythropoïèse du métabolisme du fer à l’heure où de nouveaux concepts de thérapies ciblées voient le jour, de revisiter les diagnostics différentiels et la thérapeutique des anémies mégaloblastiques, sans oublier les nouvelles approches en médecine transfusionnelle. En espérant que cette thématique d’étude continuera à attirer les plus jeunes et que de nombreux secrets sont encore à découvrir ainsi que leurs applications dans différents champs de la médecine. La rédaction remercie chaleureusement les auteurs d’avoir su relever ce défi ! Dr Christophe MARZAC, Villejuif, christophe.marzac@gustaveroussy.fr Pr Olivier HERMINE, Paris, ohermine@aphp.com Coordinateurs du « Grand Angle » -
 La prise en charge des patients présentant un lymphome de Hodgkin a significativement changé ces 5 dernières années sur la base des résultats de nombreux essais de phase III et de la disponibilité de nouvelles classes thérapeutiques qui ont changé le pronostic des patients en échec de la chimiothérapie et/ou de la radiothérapie. Le LYSA (LYmphoma Study Association) a largement contribué à l’émergence de ces nouvelles données qui ont pour certaines, établi de nouveaux standards de traitement. Le bilan d’extension de la maladie repose sur la TEP même si paradoxalement, la stratification pré-thérapeutique des patients qui guide la stratégie de prise en charge se fait encore actuellement sur des critères très « old school » basés pour les maladies localisées sur un cliché thoracique de face et la VS… De nouvelles métriques TEP telles que le volume métabolique tumoral et la distance des 2 lésions les plus éloignées émergent comme facteurs pronostiques pré-thérapeutiques et pourraient mieux stratifier le risque de la maladie et améliorer les stratégies thérapeutiques adaptées au risque. Les stratégies guidées par la TEP ont modifié les pratiques et sont devenues le standard de prise en charge permettant d’optimiser la balance entre le contrôle de la maladie et le risque immédiat et à long terme de toxicité. Cette amélioration de la balance bénéfice/risque concerne aussi la radiothérapie des formes localisées grâce à une nette réduction des champs de radiothérapie ciblant les seuls ganglions atteints (INRT). Les progrès de la biologie du lymphome de Hodgkin ont encore peu impacté les pratiques thérapeutiques mais permettent d’identifier les formes frontières avec les lymphomes agressifs médiastinaux qui ont intégré la classification WHO définissant l’entité « lymphome de forme frontière du médiastin ». L’exploration des anomalies moléculaires tumorales, difficile à obtenir par analyse de la tumeur en raison de la rareté des cellules tumorales, va être rendue plus accessible grâce à l’analyse de l’ADN tumoral plasmatique permettant une meilleure caractérisation de la tumeur, l’identification des meilleurs candidats aux nouvelles thérapeutiques dès la première ligne, et un suivi du clone tumoral sous traitement en complément de l’imagerie métabolique. Au moment où la combinaison de nouvelles molécules que ce soit le brentuximab vedotin ou les anticorps anti-PD1 à la chimiothérapie, est évaluée dans plusieurs essais randomisés prospectifs, l’enjeu est de savoir si l’utilisation de ces nouvelles molécules en première ligne thérapeutique va remplacer les stratégies actuelles chez tous les patients en supposant que leur efficacité soit au moins équivalente avec une toxicité moindre que la chimiothérapie +/- radiothérapie. Leur place dans le traitement des patients les plus âgés et les plus fragiles reste aussi à déterminer. Le défi médico-économique que représente ces molécules devrait conduire à s’interroger sur la sélection des patients les plus susceptible de répondre à ces stratégies alternatives sur la base de données biologiques et d’imagerie identifiant les patients à très haut risque d’échec de la chimiothérapie conventionnelle. Ces molécules ont actuellement une place majeure chez les patients en situation de rechute et l’efficacité des anti-PD1 en combinaison à la chimiothérapie permettant d’obtenir des taux de réponse complète de l’ordre de 90%, questionnent la pertinence des traitements intensifs suivis d’autogreffe de cellules souches hématopoiétiques (ASCT) chez les patients répondeurs. Des essais sont en cours testant des approches avec traitement de maintenance sans ASCT préalable, et pourraient changer le paradigme du traitement des lymphomes de Hodgkin en rechute. L’ensemble de ces problématiques développées dans ce nouvel opus d’Horizons Hémato dédié au lymphome de Hodgkin a été rédigé par des experts du domaine que je remercie pour leur concision et leur didactisme et qui je l’espère saura alimenter votre curiosité et vos réflexions sur ce lymphome curable chez la grande majorité des patients. Dr René-Olivier CASASNOVAS Coordinateur du "Grand Angle"
La prise en charge des patients présentant un lymphome de Hodgkin a significativement changé ces 5 dernières années sur la base des résultats de nombreux essais de phase III et de la disponibilité de nouvelles classes thérapeutiques qui ont changé le pronostic des patients en échec de la chimiothérapie et/ou de la radiothérapie. Le LYSA (LYmphoma Study Association) a largement contribué à l’émergence de ces nouvelles données qui ont pour certaines, établi de nouveaux standards de traitement. Le bilan d’extension de la maladie repose sur la TEP même si paradoxalement, la stratification pré-thérapeutique des patients qui guide la stratégie de prise en charge se fait encore actuellement sur des critères très « old school » basés pour les maladies localisées sur un cliché thoracique de face et la VS… De nouvelles métriques TEP telles que le volume métabolique tumoral et la distance des 2 lésions les plus éloignées émergent comme facteurs pronostiques pré-thérapeutiques et pourraient mieux stratifier le risque de la maladie et améliorer les stratégies thérapeutiques adaptées au risque. Les stratégies guidées par la TEP ont modifié les pratiques et sont devenues le standard de prise en charge permettant d’optimiser la balance entre le contrôle de la maladie et le risque immédiat et à long terme de toxicité. Cette amélioration de la balance bénéfice/risque concerne aussi la radiothérapie des formes localisées grâce à une nette réduction des champs de radiothérapie ciblant les seuls ganglions atteints (INRT). Les progrès de la biologie du lymphome de Hodgkin ont encore peu impacté les pratiques thérapeutiques mais permettent d’identifier les formes frontières avec les lymphomes agressifs médiastinaux qui ont intégré la classification WHO définissant l’entité « lymphome de forme frontière du médiastin ». L’exploration des anomalies moléculaires tumorales, difficile à obtenir par analyse de la tumeur en raison de la rareté des cellules tumorales, va être rendue plus accessible grâce à l’analyse de l’ADN tumoral plasmatique permettant une meilleure caractérisation de la tumeur, l’identification des meilleurs candidats aux nouvelles thérapeutiques dès la première ligne, et un suivi du clone tumoral sous traitement en complément de l’imagerie métabolique. Au moment où la combinaison de nouvelles molécules que ce soit le brentuximab vedotin ou les anticorps anti-PD1 à la chimiothérapie, est évaluée dans plusieurs essais randomisés prospectifs, l’enjeu est de savoir si l’utilisation de ces nouvelles molécules en première ligne thérapeutique va remplacer les stratégies actuelles chez tous les patients en supposant que leur efficacité soit au moins équivalente avec une toxicité moindre que la chimiothérapie +/- radiothérapie. Leur place dans le traitement des patients les plus âgés et les plus fragiles reste aussi à déterminer. Le défi médico-économique que représente ces molécules devrait conduire à s’interroger sur la sélection des patients les plus susceptible de répondre à ces stratégies alternatives sur la base de données biologiques et d’imagerie identifiant les patients à très haut risque d’échec de la chimiothérapie conventionnelle. Ces molécules ont actuellement une place majeure chez les patients en situation de rechute et l’efficacité des anti-PD1 en combinaison à la chimiothérapie permettant d’obtenir des taux de réponse complète de l’ordre de 90%, questionnent la pertinence des traitements intensifs suivis d’autogreffe de cellules souches hématopoiétiques (ASCT) chez les patients répondeurs. Des essais sont en cours testant des approches avec traitement de maintenance sans ASCT préalable, et pourraient changer le paradigme du traitement des lymphomes de Hodgkin en rechute. L’ensemble de ces problématiques développées dans ce nouvel opus d’Horizons Hémato dédié au lymphome de Hodgkin a été rédigé par des experts du domaine que je remercie pour leur concision et leur didactisme et qui je l’espère saura alimenter votre curiosité et vos réflexions sur ce lymphome curable chez la grande majorité des patients. Dr René-Olivier CASASNOVAS Coordinateur du "Grand Angle" -
 Cinq ans déjà ! Les premiers patients traités par CAR T-cells en France ont été pris en charge en 2018. Que s’est – il passé depuis ? Nos experts se sont mobilisés pour vous transmettre les derniers résultats, les perspectives, et leurs réflexions. Le Pr Houot nous explique l’apport du registre national français de DESCART qui permet de belles études de vie réelle. Le Pr Larghero nous parle de la production académique de CAR T. Est-ce possible en 2023 ? Quelles sont les contraintes et le schéma de développement ? Les Prs Boissel, Manier, et le Dr Di Blasi nous présenteront les derniers résultats des CAR T-cells dans la leucémie aiguë, le myélome et les lymphomes. Le Pr Ysaebert nous explique les défis des CAR T-cells dans la LLC, avec les difficultés en raison non seulement des comorbidités des patients mais aussi de l’immunosubversion de cette hémopathie, et des enjeux importants pour la mise en place des essais cliniques dans ce contexte. Le Pr Chabannon nous donne la vision européenne du développement des CAR T avec 6 autorisations de mise sur le marché depuis 2018, mais avec un accès inégal, en raison de la limitation dans la production, le temps de production, la logistique complexe. Bonne lecture, chers collègues ! Pr Catherine THIEBLEMONT Coordinatrice du "Grand Angle"
Cinq ans déjà ! Les premiers patients traités par CAR T-cells en France ont été pris en charge en 2018. Que s’est – il passé depuis ? Nos experts se sont mobilisés pour vous transmettre les derniers résultats, les perspectives, et leurs réflexions. Le Pr Houot nous explique l’apport du registre national français de DESCART qui permet de belles études de vie réelle. Le Pr Larghero nous parle de la production académique de CAR T. Est-ce possible en 2023 ? Quelles sont les contraintes et le schéma de développement ? Les Prs Boissel, Manier, et le Dr Di Blasi nous présenteront les derniers résultats des CAR T-cells dans la leucémie aiguë, le myélome et les lymphomes. Le Pr Ysaebert nous explique les défis des CAR T-cells dans la LLC, avec les difficultés en raison non seulement des comorbidités des patients mais aussi de l’immunosubversion de cette hémopathie, et des enjeux importants pour la mise en place des essais cliniques dans ce contexte. Le Pr Chabannon nous donne la vision européenne du développement des CAR T avec 6 autorisations de mise sur le marché depuis 2018, mais avec un accès inégal, en raison de la limitation dans la production, le temps de production, la logistique complexe. Bonne lecture, chers collègues ! Pr Catherine THIEBLEMONT Coordinatrice du "Grand Angle" -
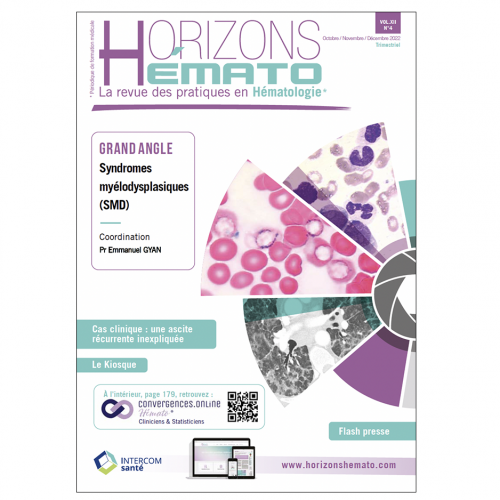 Une riche actualité concerne les syndromes myélodysplasiques au cours de ces derniers mois : Une nouvelle classification diagnostique, une nouvelle classification pronostique, de nouveaux médicaments, un nouveau syndrome associé à de l’inflammation, sans oublier les espoirs pour les SMD de haut risque, stimulés par des résultats probants d’essais thérapeutiques dans les LAM. C’est avec beaucoup de plaisir que le groupe de travail de ce numéro Grand Angle SMD vous présente une synthèse sur ces pathologies hétérogènes, qui concernent des patients de plus en plus âgés. Le diagnostic peut faire appel au diagnostic moléculaire, non disponible partout, ce qui rend nécessaire une réflexion sur l’adéquation des moyens mobilisés pour chaque patient en fonction de son contexte particulier. Le NGS s’invite désormais dans la classification pronostique IPSS-M, avec là aussi des enjeux thérapeutiques qui peuvent être affinés. Il est loin le temps où on calculait l’IPSS de tête, vous aurez besoin d’un calculateur online ou d’une application sur votre téléphone pour calculer ce nouveau score. Dans les syndromes myélodysplasiques de bas risque, l’événement marquant en France est la disponibilité du luspatercept, qui devrait pouvoir rendre service à certains patients réfractaires aux ASE. Vous trouverez aussi une description des avancées dans l’organisation des parcours de soins, qui peuvent être utiles y compris en dehors du contexte des myélodysplasies. Nous espérons que ce numéro Grand Angle vous apportera des informations utiles pour votre pratique comme pour la pédagogie vis-à-vis de nos jeunes collègues. Bien amicalement à tous. Pr Emmanuel GYAN, Tours. Coordinateur du « Grand Angle. E.GYAN@chu-tours.fr
Une riche actualité concerne les syndromes myélodysplasiques au cours de ces derniers mois : Une nouvelle classification diagnostique, une nouvelle classification pronostique, de nouveaux médicaments, un nouveau syndrome associé à de l’inflammation, sans oublier les espoirs pour les SMD de haut risque, stimulés par des résultats probants d’essais thérapeutiques dans les LAM. C’est avec beaucoup de plaisir que le groupe de travail de ce numéro Grand Angle SMD vous présente une synthèse sur ces pathologies hétérogènes, qui concernent des patients de plus en plus âgés. Le diagnostic peut faire appel au diagnostic moléculaire, non disponible partout, ce qui rend nécessaire une réflexion sur l’adéquation des moyens mobilisés pour chaque patient en fonction de son contexte particulier. Le NGS s’invite désormais dans la classification pronostique IPSS-M, avec là aussi des enjeux thérapeutiques qui peuvent être affinés. Il est loin le temps où on calculait l’IPSS de tête, vous aurez besoin d’un calculateur online ou d’une application sur votre téléphone pour calculer ce nouveau score. Dans les syndromes myélodysplasiques de bas risque, l’événement marquant en France est la disponibilité du luspatercept, qui devrait pouvoir rendre service à certains patients réfractaires aux ASE. Vous trouverez aussi une description des avancées dans l’organisation des parcours de soins, qui peuvent être utiles y compris en dehors du contexte des myélodysplasies. Nous espérons que ce numéro Grand Angle vous apportera des informations utiles pour votre pratique comme pour la pédagogie vis-à-vis de nos jeunes collègues. Bien amicalement à tous. Pr Emmanuel GYAN, Tours. Coordinateur du « Grand Angle. E.GYAN@chu-tours.fr

