-
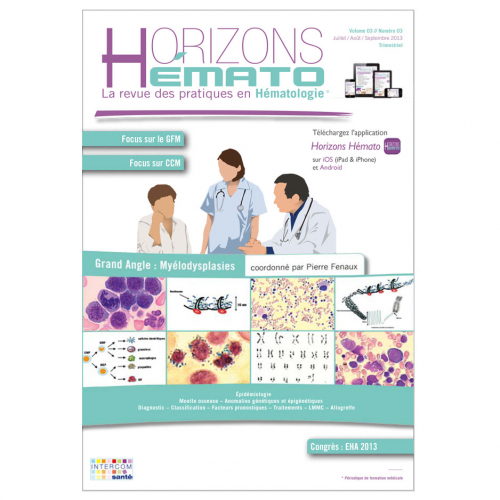 Les SMD restent, comme le rappelle Céline Berthon, une pathologie du sujet âgé dont l’origine est le plus souvent inconnue, à part le cas des SMD secondaires à une chimio- ou radiothérapie, qui sont particulièrement graves. Thomas Cluzeau et Raphaël Itzykson détaillent les progrès très récents en matière de physiopathologie des SMD, avec notamment des mutations de gènes impliqués dans l’épigénétique ou dans l’épissage génique, l’haplo-insuffisance pour certains gènes, un possible rôle du micro-environnement pour expliquer l’apoptose excessive des précurseurs aux stades précoces de la maladie, puis l’évolution en forme de haut risque voire en LAM. Emmanuel Gyan nous rappelle ensuite que le diagnostic de SMD repose toujours sur l’hémogramme (montrant des cytopénies) et un examen attentif du myélogramme (montrant une dysmyélopoïèse +/- un excès de blastes). La classification actuellement en cours est celle de l'OMS version 2008. Le caryotype médullaire a surtout un intérêt pronostique et, joint aux cytopénies et au pourcentage de blastes médullaires, constitue le score IPSS servant, comme le souligne Sophie Dimicoli, de guide actuel au traitement. Ce score IPSS a été récemment mis à jour (R-IPSS), et les facteurs pronostiques s’enrichissent avec la recherche de mutations géniques somatiques, d’une myélofibrose et peut-être de l’immunophénotype des cellules myéloïdes. Le seul traitement curatif des SMD, comme le rappelle Marie Robin, est l’allogreffe de cellules souches, que toutefois seule une minorité des patients peut recevoir. Pour les autres, Thomas Prébet détaille les bénéfices importants en termes de survie apportés par les hypométhylants, particulièrement l’azacycitidine. Pour les SMD de faible risque, Lionel Adès souligne le fait que le traitement de l’anémie ne fait plus seulement appel aux transfusions, mais aussi à l'EPO, au lénalidomide, et en seconde ligne aux hypométhylants et parfois au traitement immunosuppresseur. Enfin, Thorsten Braun décrit la LMMC, aux confins du SMD et du SMP, qui peut bénéficier de l’allogreffe et sans doute aussi des hypométhylants. Les progrès thérapeutiques ne peuvent venir que d’essais thérapeutiques bien menés. Le Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM) essaie, comme le souligne Fatiha Chermat, de mener de tels essais dans les SMD. Par ailleurs, le rôle des associations de patients comme Connaître et Combattre les Myélodysplasies (CCM) est, comme le décrit Patrick Festy, très important dans la prise en charge de ces maladies chroniques. Pierre FENAUX Coordinateur du Grand Angle « Myélodysplasies ». Service hématologie seniors, Hôpital St-Louis (AP-HP) et université Paris 7. Professeur d'hématologie (Paris 7). président du Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM). pierre.fenaux@sls.aphp.fr
Les SMD restent, comme le rappelle Céline Berthon, une pathologie du sujet âgé dont l’origine est le plus souvent inconnue, à part le cas des SMD secondaires à une chimio- ou radiothérapie, qui sont particulièrement graves. Thomas Cluzeau et Raphaël Itzykson détaillent les progrès très récents en matière de physiopathologie des SMD, avec notamment des mutations de gènes impliqués dans l’épigénétique ou dans l’épissage génique, l’haplo-insuffisance pour certains gènes, un possible rôle du micro-environnement pour expliquer l’apoptose excessive des précurseurs aux stades précoces de la maladie, puis l’évolution en forme de haut risque voire en LAM. Emmanuel Gyan nous rappelle ensuite que le diagnostic de SMD repose toujours sur l’hémogramme (montrant des cytopénies) et un examen attentif du myélogramme (montrant une dysmyélopoïèse +/- un excès de blastes). La classification actuellement en cours est celle de l'OMS version 2008. Le caryotype médullaire a surtout un intérêt pronostique et, joint aux cytopénies et au pourcentage de blastes médullaires, constitue le score IPSS servant, comme le souligne Sophie Dimicoli, de guide actuel au traitement. Ce score IPSS a été récemment mis à jour (R-IPSS), et les facteurs pronostiques s’enrichissent avec la recherche de mutations géniques somatiques, d’une myélofibrose et peut-être de l’immunophénotype des cellules myéloïdes. Le seul traitement curatif des SMD, comme le rappelle Marie Robin, est l’allogreffe de cellules souches, que toutefois seule une minorité des patients peut recevoir. Pour les autres, Thomas Prébet détaille les bénéfices importants en termes de survie apportés par les hypométhylants, particulièrement l’azacycitidine. Pour les SMD de faible risque, Lionel Adès souligne le fait que le traitement de l’anémie ne fait plus seulement appel aux transfusions, mais aussi à l'EPO, au lénalidomide, et en seconde ligne aux hypométhylants et parfois au traitement immunosuppresseur. Enfin, Thorsten Braun décrit la LMMC, aux confins du SMD et du SMP, qui peut bénéficier de l’allogreffe et sans doute aussi des hypométhylants. Les progrès thérapeutiques ne peuvent venir que d’essais thérapeutiques bien menés. Le Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM) essaie, comme le souligne Fatiha Chermat, de mener de tels essais dans les SMD. Par ailleurs, le rôle des associations de patients comme Connaître et Combattre les Myélodysplasies (CCM) est, comme le décrit Patrick Festy, très important dans la prise en charge de ces maladies chroniques. Pierre FENAUX Coordinateur du Grand Angle « Myélodysplasies ». Service hématologie seniors, Hôpital St-Louis (AP-HP) et université Paris 7. Professeur d'hématologie (Paris 7). président du Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM). pierre.fenaux@sls.aphp.fr -
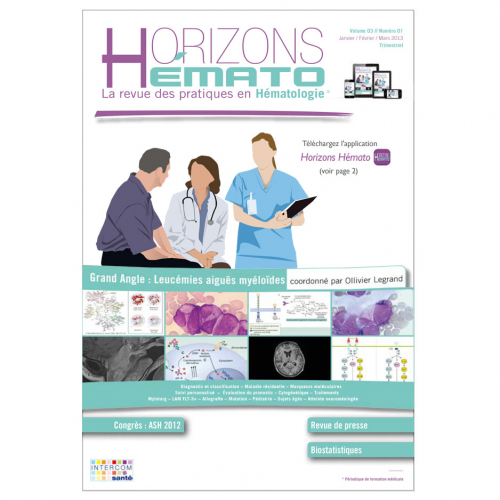 Ce numéro d'Horizons Hémato nous propose de faire un tour d’horizon complet sur la leucémie aiguë myéloblastique (LAM) de l’adulte et de l’enfant. Le pronostic de cette pathologie a vu des améliorations, ces dernières décennies, surtout chez les sujets « jeunes » âgés de moins de 60 ans, mais ne s’est que peu amélioré chez les sujets plus âgés. Ces progrès ont été accomplis autant grâce aux traitements de supports que par les thérapeutiques antitumorales. Le traitement de référence des leucémies aiguës myéloblastiques est resté le même depuis de nombreuses années combinant une anthracycline et de la cytarabine à différentes posologies, suivie d’une phase de consolidation incluant souvent une allogreffe. Depuis quelques années cette maladie hétérogène a bénéficié de nouvelles connaissances, en particulier au niveau génétique, ce qui a permis d’affiner le pronostic de cette hémopathie, permettant d’adapter l’intensité des traitements en particulier les indications d’allogreffe, d’apprécier le taux de maladie résiduelle, par exemple par la quantification de NPM1, et dans certains cas de déboucher sur des thérapeutiques ciblées, par l’administration d’inhibiteurs de Flt3. Le Mylotarg®, un anticorps anti-CD33 couplé à de la calichéamycine, qui après avoir failli être retiré du marché, semble être en sursis et peut-être mieux suite à plusieurs études randomisées de phase III montrant sa supériorité par rapport au traitement standard, au moins dans les LAM sans facteurs pronostiques péjoratifs. Des progrès ont été faits aussi au niveau de la réalisation des allogreffes, permettant ainsi de proposer cette stratégie thérapeutique à des patients jusque-là non éligibles grâce au recours aux donneurs alternatifs et aux conditionnements à intensité réduite chez des patients âgés. Tous ces différents thèmes sont développés dans ce numéro d’Horizons Hémato qui a pour objectif de faire le point sur cette pathologie au niveau biologique et thérapeutique. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la rédaction de ce numéro consacré aux LAM. OLLIVIER LEGRAND Hôpital Saint-Antoine, service d'hématologie clinique ollivier.legrand@sat.aphp.fr
Ce numéro d'Horizons Hémato nous propose de faire un tour d’horizon complet sur la leucémie aiguë myéloblastique (LAM) de l’adulte et de l’enfant. Le pronostic de cette pathologie a vu des améliorations, ces dernières décennies, surtout chez les sujets « jeunes » âgés de moins de 60 ans, mais ne s’est que peu amélioré chez les sujets plus âgés. Ces progrès ont été accomplis autant grâce aux traitements de supports que par les thérapeutiques antitumorales. Le traitement de référence des leucémies aiguës myéloblastiques est resté le même depuis de nombreuses années combinant une anthracycline et de la cytarabine à différentes posologies, suivie d’une phase de consolidation incluant souvent une allogreffe. Depuis quelques années cette maladie hétérogène a bénéficié de nouvelles connaissances, en particulier au niveau génétique, ce qui a permis d’affiner le pronostic de cette hémopathie, permettant d’adapter l’intensité des traitements en particulier les indications d’allogreffe, d’apprécier le taux de maladie résiduelle, par exemple par la quantification de NPM1, et dans certains cas de déboucher sur des thérapeutiques ciblées, par l’administration d’inhibiteurs de Flt3. Le Mylotarg®, un anticorps anti-CD33 couplé à de la calichéamycine, qui après avoir failli être retiré du marché, semble être en sursis et peut-être mieux suite à plusieurs études randomisées de phase III montrant sa supériorité par rapport au traitement standard, au moins dans les LAM sans facteurs pronostiques péjoratifs. Des progrès ont été faits aussi au niveau de la réalisation des allogreffes, permettant ainsi de proposer cette stratégie thérapeutique à des patients jusque-là non éligibles grâce au recours aux donneurs alternatifs et aux conditionnements à intensité réduite chez des patients âgés. Tous ces différents thèmes sont développés dans ce numéro d’Horizons Hémato qui a pour objectif de faire le point sur cette pathologie au niveau biologique et thérapeutique. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la rédaction de ce numéro consacré aux LAM. OLLIVIER LEGRAND Hôpital Saint-Antoine, service d'hématologie clinique ollivier.legrand@sat.aphp.fr -
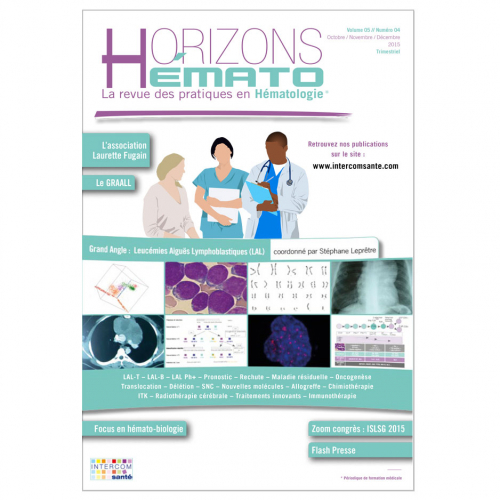 Alors que la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL) est une hémopathie rare, un groupe d'hématologues motivés a su susciter des intérêts particuliers sur cette pathologie et attirer d'autres hématologues au sein d'un groupe coopérateur dont son nom a une symbolique évidente : le GRAALL. « Toujours améliorer le pronostic de cette hémopathie maligne tout en diminuant la toxicité de son traitement » est le « leitmotiv » du conseil scientifique du GRAAL. En effet, son traitement peut être assimilé à une oeuvre musicale, tant sa forme et sa structure sont subtiles voire compliquées (induction, blocs de consolidation, réinduction, nouveaux blocs de consolidation, rattrapage, allogreffe, entretien, etc.), avec des vrais tempos rapides (enchaînement rapide des différentes parties), avec une écriture selon une méthodologie adéquate (clignotants pronostiques revisités) mais avec encore un nombre trop limité d'instruments (une dizaine de drogues) mais qui s'enrichit aujourd'hui (anticorps bispécifiques, CAR T cell, nélarabine, ITK, etc.). J'ai pu personnellement orchestrer une oeuvre : la prise en charge des lymphomes lymphoblastiques. Alors jeune chef d'orchestre, toutes les voix constituant le GRAALL et le LYSA, m'ont fait confiance, qu'elles soient sopranos, ténors, barytons. Je les en remercie. J'ai proposé, pour ce Grand Angle « LAL », plusieurs voix qui semblent toutes s'accorder. De la biologie, du traitement, à la prise en charge des toxicités spécifiques de l'asparginase par exemple, vous trouverez une revue synthétique du sujet. Je remercie vivement tous les auteurs et je vous souhaite une bonne lecture !
Alors que la Leucémie Aiguë Lymphoblastique (LAL) est une hémopathie rare, un groupe d'hématologues motivés a su susciter des intérêts particuliers sur cette pathologie et attirer d'autres hématologues au sein d'un groupe coopérateur dont son nom a une symbolique évidente : le GRAALL. « Toujours améliorer le pronostic de cette hémopathie maligne tout en diminuant la toxicité de son traitement » est le « leitmotiv » du conseil scientifique du GRAAL. En effet, son traitement peut être assimilé à une oeuvre musicale, tant sa forme et sa structure sont subtiles voire compliquées (induction, blocs de consolidation, réinduction, nouveaux blocs de consolidation, rattrapage, allogreffe, entretien, etc.), avec des vrais tempos rapides (enchaînement rapide des différentes parties), avec une écriture selon une méthodologie adéquate (clignotants pronostiques revisités) mais avec encore un nombre trop limité d'instruments (une dizaine de drogues) mais qui s'enrichit aujourd'hui (anticorps bispécifiques, CAR T cell, nélarabine, ITK, etc.). J'ai pu personnellement orchestrer une oeuvre : la prise en charge des lymphomes lymphoblastiques. Alors jeune chef d'orchestre, toutes les voix constituant le GRAALL et le LYSA, m'ont fait confiance, qu'elles soient sopranos, ténors, barytons. Je les en remercie. J'ai proposé, pour ce Grand Angle « LAL », plusieurs voix qui semblent toutes s'accorder. De la biologie, du traitement, à la prise en charge des toxicités spécifiques de l'asparginase par exemple, vous trouverez une revue synthétique du sujet. Je remercie vivement tous les auteurs et je vous souhaite une bonne lecture ! -
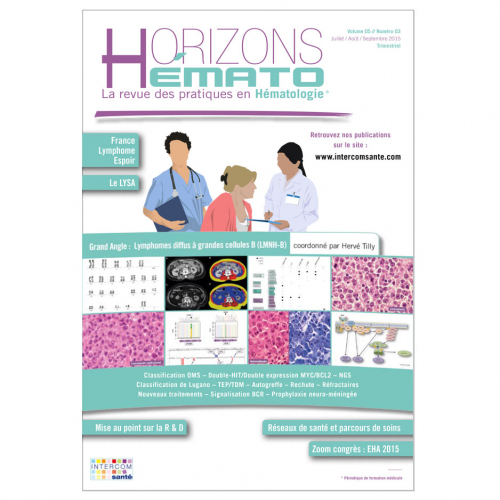 Nous avons beaucoup appris des lymphomes B diffus à grandes cellules ces dernières années. Nous sommes capables de reconnaître différentes entités définies par leur aspect anatomopathologique ou par les voies qui les caractérisent. Des nombreuses altérations génomiques ont été mises en évidence par le séquençage à haut débit dans ces entités qui ouvrent l’espoir de nouveaux traitements. L’association du rituximab à la chimiothérapie a permis de guérir la grande majorité des jeunes patients et près de la moitié des plus vieux. La TEP a amélioré l’évaluation initiale et celle de la réponse au traitement, elle permet l’adaptation de certains traitements. Nos efforts futurs devront se porter sur la caractérisation complexe de la maladie au niveau génomique, transcriptionnel, épigénétique, protéomique et environnemental. L’accès de prélèvements aux plateformes d’analyse sera donc crucial pour permettre ces progrès et pour déterminer les voies sur lesquelles des combinaisons de traitements personnalisés pourront agir. L’identification d’anomalies présentes dans l’ADN circulant de nos malades sera probablement un outil de diagnostic et de suivi très utile. L’amélioration des thérapeutiques devra porter plus particulièrement sur les patients à haut risque de maladie réfractaire ou de rechute précoce comme, par exemple, celles dans lesquelles MYC est impliqué mais aussi sur les populations plus fragiles et plus âgées chez lesquelles des traitements mieux ciblés et moins toxiques seront plus rapidement développés. Les groupes coopérateurs comme le LYSA devront jouer un rôle majeur dans une réflexion globale de l’appréhension de la maladie, dans la diffusion des connaissances et des prises en charge, dans la mise à disposition des échantillons et de leur analyse. Ce sont ces interrogations et ces espoirs qui sont développés dans ce numéro d’Horizons Hémato consacré aux lymphomes B diffus à grandes cellules. Bonne lecture !
Nous avons beaucoup appris des lymphomes B diffus à grandes cellules ces dernières années. Nous sommes capables de reconnaître différentes entités définies par leur aspect anatomopathologique ou par les voies qui les caractérisent. Des nombreuses altérations génomiques ont été mises en évidence par le séquençage à haut débit dans ces entités qui ouvrent l’espoir de nouveaux traitements. L’association du rituximab à la chimiothérapie a permis de guérir la grande majorité des jeunes patients et près de la moitié des plus vieux. La TEP a amélioré l’évaluation initiale et celle de la réponse au traitement, elle permet l’adaptation de certains traitements. Nos efforts futurs devront se porter sur la caractérisation complexe de la maladie au niveau génomique, transcriptionnel, épigénétique, protéomique et environnemental. L’accès de prélèvements aux plateformes d’analyse sera donc crucial pour permettre ces progrès et pour déterminer les voies sur lesquelles des combinaisons de traitements personnalisés pourront agir. L’identification d’anomalies présentes dans l’ADN circulant de nos malades sera probablement un outil de diagnostic et de suivi très utile. L’amélioration des thérapeutiques devra porter plus particulièrement sur les patients à haut risque de maladie réfractaire ou de rechute précoce comme, par exemple, celles dans lesquelles MYC est impliqué mais aussi sur les populations plus fragiles et plus âgées chez lesquelles des traitements mieux ciblés et moins toxiques seront plus rapidement développés. Les groupes coopérateurs comme le LYSA devront jouer un rôle majeur dans une réflexion globale de l’appréhension de la maladie, dans la diffusion des connaissances et des prises en charge, dans la mise à disposition des échantillons et de leur analyse. Ce sont ces interrogations et ces espoirs qui sont développés dans ce numéro d’Horizons Hémato consacré aux lymphomes B diffus à grandes cellules. Bonne lecture ! -
 Les pathologies hémorragiques constitutionnelles de l’hémostase sont rares, mais variées. Au-delà des aspects diagnostiques partant de la symptomatologie commune mais très polymorphe qu’est le syndrome hémorragique, elles ouvrent des champs très divers. Compte tenu de l’histoire, ces pathologies sont rarement prises en charge directement dans les services d’hématologie clinique et les centres de traitement de maladies hémorragiques sont le plus souvent rattachés à des laboratoires spécialisés en hémostase, mais aussi à des services de pédiatrie, de médecine interne… Un laboratoire d’hématologie biologique, et plus spécifiquement de biologie spécialisée de l’hémostase, reste la colonne vertébrale indispensable à toute structure de prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces maladies. L’hémostase clinique est en effet le prototype d’une discipline transversale clinico-biologique, où la séparation entre clinique et biologique est artificielle et dénuée se sens. Nous avons voulu dans ce numéro, donner un aperçu des différentes problématiques et faire apparaître la diversité clinique, biologique, génétique, diagnostique de ces pathologies. L’arrivée de technologies nouvelles, biologiques, génétiques, thérapeutiques, la modification phénotypique qu’on peut attendre de la présentation de la maladie, liée aux modifications des stratégies thérapeutiques de l’hémophilie au cours des deux dernières décennies vont certainement bouleverser les approches dans les 5 à 10 ans à venir. La situation décrite est celle de 2015, dans une spécialité qui constitue donc une niche en pleine évolution dans le monde de l’hématologie. Enfin, un grand merci à tous les auteurs qui, chacun sousun angle particulier, ont accepté de participer à ce numéro. Thierry LAMBERT Coordinateur du Grand Format « hémophilie et maladies hémorragiques constitutionnelles ». Centre de Référence pour le Traitement des Hémophiles, Le Kremlin-Bicêtre. thierry.lambert@aphp.fr
Les pathologies hémorragiques constitutionnelles de l’hémostase sont rares, mais variées. Au-delà des aspects diagnostiques partant de la symptomatologie commune mais très polymorphe qu’est le syndrome hémorragique, elles ouvrent des champs très divers. Compte tenu de l’histoire, ces pathologies sont rarement prises en charge directement dans les services d’hématologie clinique et les centres de traitement de maladies hémorragiques sont le plus souvent rattachés à des laboratoires spécialisés en hémostase, mais aussi à des services de pédiatrie, de médecine interne… Un laboratoire d’hématologie biologique, et plus spécifiquement de biologie spécialisée de l’hémostase, reste la colonne vertébrale indispensable à toute structure de prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces maladies. L’hémostase clinique est en effet le prototype d’une discipline transversale clinico-biologique, où la séparation entre clinique et biologique est artificielle et dénuée se sens. Nous avons voulu dans ce numéro, donner un aperçu des différentes problématiques et faire apparaître la diversité clinique, biologique, génétique, diagnostique de ces pathologies. L’arrivée de technologies nouvelles, biologiques, génétiques, thérapeutiques, la modification phénotypique qu’on peut attendre de la présentation de la maladie, liée aux modifications des stratégies thérapeutiques de l’hémophilie au cours des deux dernières décennies vont certainement bouleverser les approches dans les 5 à 10 ans à venir. La situation décrite est celle de 2015, dans une spécialité qui constitue donc une niche en pleine évolution dans le monde de l’hématologie. Enfin, un grand merci à tous les auteurs qui, chacun sousun angle particulier, ont accepté de participer à ce numéro. Thierry LAMBERT Coordinateur du Grand Format « hémophilie et maladies hémorragiques constitutionnelles ». Centre de Référence pour le Traitement des Hémophiles, Le Kremlin-Bicêtre. thierry.lambert@aphp.fr -
 Une espérance de vie transformée, cinq ITK disponibles, et bientôt encore de nouvelles molécules, un ciblage diagnostique et bientôt thérapeutique de la cellule souche leucémique, un suivi biologique structuré et de plus en plus performant, une puissance thérapeutique telle que le concept d’arrêts de traitements s’impose jusqu’à devenir un nouvel objectif thérapeutique dans la LMC, des recommandations thérapeutiques évoluant vite au gré d’une exigence grandissante de résultats… Comment concilier ces exigences avec la persistance de LMC réfractaires et de transformations, l’instabilité génétique de certaines, les effets secondaires graves émergents, une qualité de vie parfois désastreuse, le manque d’observance aux traitements, l’augmentation de la file active de patients non proportionnelle au nombre d’hématologues les prenant en charge ? Et si une des clefs résidait dans la personnalisation de la prise en charge ? Au sein des recommandations globales, le chemin particulier de chaque patient nécessite une adaptation de prise en charge rendue possible par l’expertise des équipes médicales et paramédicales. Une perte de réponse par manque d’observance est incomparable à une perte de réponse par acquisition de résistances ou par impasse thérapeutique d’origine iatrogène. La première requiert une amélioration du soutien dans le parcours de soins du patient, alors que la seconde nécessite une adaptation spécifique thérapeutique. Les objectifs thérapeutiques se structurent au sein de ce contexte de problématiques multiples et de patients uniques : maintenir l’espérance de vie pour les plus réfractaires, viser et maintenir l’arrêt de traitement pour les meilleurs répondeurs, en évitant pour tous les effets secondaires graves… et quels que soient les types de LMC, maintenir une qualité de vie justifiant tous nos efforts. Tout cela à quel prix ? L'enjeu est peut-être avant tout pharmaco-économique. Ce qui dépasse largement notre champ d'action médical. Aude CHARBONNIER Coordinatrice du Grand Angle « Leucémie myéloïde chronique ». Hématologue, Institut Paoli-Calmettes. charbonniera@ipc.unicancer.fr
Une espérance de vie transformée, cinq ITK disponibles, et bientôt encore de nouvelles molécules, un ciblage diagnostique et bientôt thérapeutique de la cellule souche leucémique, un suivi biologique structuré et de plus en plus performant, une puissance thérapeutique telle que le concept d’arrêts de traitements s’impose jusqu’à devenir un nouvel objectif thérapeutique dans la LMC, des recommandations thérapeutiques évoluant vite au gré d’une exigence grandissante de résultats… Comment concilier ces exigences avec la persistance de LMC réfractaires et de transformations, l’instabilité génétique de certaines, les effets secondaires graves émergents, une qualité de vie parfois désastreuse, le manque d’observance aux traitements, l’augmentation de la file active de patients non proportionnelle au nombre d’hématologues les prenant en charge ? Et si une des clefs résidait dans la personnalisation de la prise en charge ? Au sein des recommandations globales, le chemin particulier de chaque patient nécessite une adaptation de prise en charge rendue possible par l’expertise des équipes médicales et paramédicales. Une perte de réponse par manque d’observance est incomparable à une perte de réponse par acquisition de résistances ou par impasse thérapeutique d’origine iatrogène. La première requiert une amélioration du soutien dans le parcours de soins du patient, alors que la seconde nécessite une adaptation spécifique thérapeutique. Les objectifs thérapeutiques se structurent au sein de ce contexte de problématiques multiples et de patients uniques : maintenir l’espérance de vie pour les plus réfractaires, viser et maintenir l’arrêt de traitement pour les meilleurs répondeurs, en évitant pour tous les effets secondaires graves… et quels que soient les types de LMC, maintenir une qualité de vie justifiant tous nos efforts. Tout cela à quel prix ? L'enjeu est peut-être avant tout pharmaco-économique. Ce qui dépasse largement notre champ d'action médical. Aude CHARBONNIER Coordinatrice du Grand Angle « Leucémie myéloïde chronique ». Hématologue, Institut Paoli-Calmettes. charbonniera@ipc.unicancer.fr -
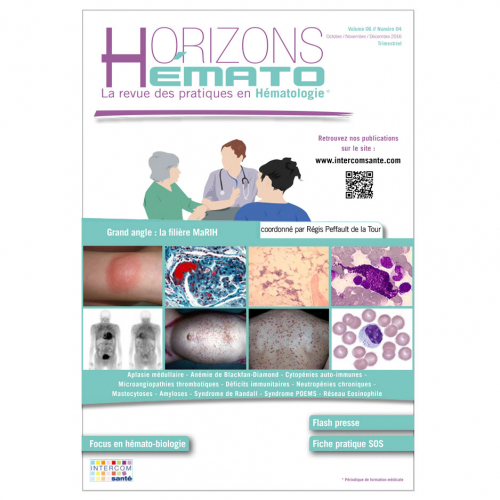 La maladie rare est définie par une prévalence de 1 sur 2 000. En France, ces maladies touchent plus de 3 millions de personnes avec plus de 8 000 maladies identifiées à ce jour. La France est un leader européen de par son engagement pour l’amélioration de la prise en charge de ces maladies. Sous l’impulsion du Ministère de la santé, deux plans nationaux maladies rares « PNMR » ont d’ores et déjà étaient mis en place : Le PNMR 1 2005-2008 a labellisé 131 centres de référence maladies rares « CRMR » associés à 501 centres de compétences « CCMR » permettant d’assurer la prise en charge et le suivi des patients au plus proche de leur domicile, en lien avec les associations de patients. Les CRMR ont 5 missions : - la coordination et l’animation de son réseau en organisant entre autre des journées nationales scientifiques ; - l’expertise clinique à travers des réunions de concertation pluridisciplinaire « RCP », l’élaboration de recommandations et de protocoles nationaux de diagnostic et de soins « PNDS » et le recueil épidémiologique ; - le recours en assurant une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle diagnostique, thérapeutique et de suivi ; - la recherche translationnelle, clinique ou organisationnelle contribuant à la reconnaissance de son expertise ; - l’enseignement et la formation des professionnels de la santé. Le PNMR 2 2011-2014, prolongé jusqu’en 2016, a renforcé les liens entre les différents acteurs de la prise en charge en les intégrant dans un seul et même réseau, sur un champ large et cohérent de maladies rares soit proches dans leurs manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte d’un même organe ou système. Ces réseaux, appelés filières de santé maladies rares « FSMR » ont pour missions d’animer et de coordonner les actions entre CRMR, CCMR, laboratoires de recherche et/ou diagnostic et associations de patients en partenariat avec les sociétés savantes afin d’instaurer des synergies sur des problématiques transversales (amélioration du soin, développement de la recherche, la communication et la formation). En 2014, 23 FSMR ont été labellisées par le Ministère de la santé, dont MaRIH pour les maladies rares immuno-hématologiques. Un troisième plan est actuellement en cours d’élaboration afin de consolider les efforts entrepris par ces deux premiers et un nouvel appel à projets visant la relabellisation ou la création de nouveaux CRMR est ouverte aux candidatures jusqu’au 26 janvier 2017. Au travers de ces différents plans, la France reste un leader européen de la prise en charge des maladies rares. Récemment, les réseaux européens maladies rares créés l’ont été sur le modèle des filières de santé illustrant une nouvelle fois le rôle innovant de notre pays dans ce domaine. La filière de santé maladie rare MaRIH regroupe 12 centres de références qui postulent tous à leur relabélisation et appartient au réseau EuroBloodNet récemment créé, l’ensemble permettant d’apporter à nos patients une prise en charge clinique de tout premier plan, une recherche de grande qualité et une formation des plus jeunes que beaucoup nous envie. Bonne lecture à tous ! Régis PEFFAULT DE LA TOUR Coordinateur du Grand Angle "La filière MaRiH" Hôpital Saint- Louis, AP-HP, Paris. regis.peffaultdelatour@aphp.fr
La maladie rare est définie par une prévalence de 1 sur 2 000. En France, ces maladies touchent plus de 3 millions de personnes avec plus de 8 000 maladies identifiées à ce jour. La France est un leader européen de par son engagement pour l’amélioration de la prise en charge de ces maladies. Sous l’impulsion du Ministère de la santé, deux plans nationaux maladies rares « PNMR » ont d’ores et déjà étaient mis en place : Le PNMR 1 2005-2008 a labellisé 131 centres de référence maladies rares « CRMR » associés à 501 centres de compétences « CCMR » permettant d’assurer la prise en charge et le suivi des patients au plus proche de leur domicile, en lien avec les associations de patients. Les CRMR ont 5 missions : - la coordination et l’animation de son réseau en organisant entre autre des journées nationales scientifiques ; - l’expertise clinique à travers des réunions de concertation pluridisciplinaire « RCP », l’élaboration de recommandations et de protocoles nationaux de diagnostic et de soins « PNDS » et le recueil épidémiologique ; - le recours en assurant une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle diagnostique, thérapeutique et de suivi ; - la recherche translationnelle, clinique ou organisationnelle contribuant à la reconnaissance de son expertise ; - l’enseignement et la formation des professionnels de la santé. Le PNMR 2 2011-2014, prolongé jusqu’en 2016, a renforcé les liens entre les différents acteurs de la prise en charge en les intégrant dans un seul et même réseau, sur un champ large et cohérent de maladies rares soit proches dans leurs manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte d’un même organe ou système. Ces réseaux, appelés filières de santé maladies rares « FSMR » ont pour missions d’animer et de coordonner les actions entre CRMR, CCMR, laboratoires de recherche et/ou diagnostic et associations de patients en partenariat avec les sociétés savantes afin d’instaurer des synergies sur des problématiques transversales (amélioration du soin, développement de la recherche, la communication et la formation). En 2014, 23 FSMR ont été labellisées par le Ministère de la santé, dont MaRIH pour les maladies rares immuno-hématologiques. Un troisième plan est actuellement en cours d’élaboration afin de consolider les efforts entrepris par ces deux premiers et un nouvel appel à projets visant la relabellisation ou la création de nouveaux CRMR est ouverte aux candidatures jusqu’au 26 janvier 2017. Au travers de ces différents plans, la France reste un leader européen de la prise en charge des maladies rares. Récemment, les réseaux européens maladies rares créés l’ont été sur le modèle des filières de santé illustrant une nouvelle fois le rôle innovant de notre pays dans ce domaine. La filière de santé maladie rare MaRIH regroupe 12 centres de références qui postulent tous à leur relabélisation et appartient au réseau EuroBloodNet récemment créé, l’ensemble permettant d’apporter à nos patients une prise en charge clinique de tout premier plan, une recherche de grande qualité et une formation des plus jeunes que beaucoup nous envie. Bonne lecture à tous ! Régis PEFFAULT DE LA TOUR Coordinateur du Grand Angle "La filière MaRiH" Hôpital Saint- Louis, AP-HP, Paris. regis.peffaultdelatour@aphp.fr -
 En un peu plus d’une décennie, la prise en charge des lymphomes à cellules du manteau s’est modifiée de façon drastique. D’une maladie au pronostic sombre avec une médiane de survie à moins de 3 ans il y a 15 ans, on est passé à une maladie dont la survie dépasse 7-8 ans pour 70 à 80 % des patients, et cela quel que soit leur âge ! Que s’est- il passé ? Un enchaînement de plusieurs innovations dans différents domaines tels que la biologie et la thérapeutique… Nous pouvons ainsi énumérer : le décryptage de sa physiopathologique avec la caractérisation de plusieurs voies de signalisation majeures impliquées dans sa lymphomagenèse ; plusieurs sous-types de lymphomes du manteau identifiés ; sur le plan thérapeutique, l’introduction en première ligne de l’aracytine en polychimiothérapie qui a détrôné le sacro-saint « CHOP » en première ligne pour les sujets jeunes (moins de 65 ans), l’introduction du rituximab en association à la chimiothérapie en induction, mais aussi chez les patients âgés (plus de 65 ans) en entretien, et chez les patients jeunes le traitement intensif avec greffe de cellules souches autologues. Mais surtout, c’est le premier lymphome où l’utilisation d’un inhibiteur de tyrosine kinase a montré un bénéfice majeur dans le traitement des patients en rechute ou réfractaires, et que d’autres nouveaux agents tels que les immunomodulateurs ou inhibiteurs du protéasome ont montré une efficacité. Actuellement nous en sommes donc au point de pouvoir demander plus en termes de réponse, et d’analyser les résultats thérapeutiques avec des techniques moléculaires ou d’imagerie fonctionnelle. Un grand merci à l’ensemble des rédacteurs qui ont accepté de nous rapporter ces dernières avancées dans le lymphome à cellules du manteau ! Pr Catherine THIEBLEMONT Coordinatrice du dossier. Hôpital-Saint Louis, Paris. catherine.thieblemont@aphp.fr
En un peu plus d’une décennie, la prise en charge des lymphomes à cellules du manteau s’est modifiée de façon drastique. D’une maladie au pronostic sombre avec une médiane de survie à moins de 3 ans il y a 15 ans, on est passé à une maladie dont la survie dépasse 7-8 ans pour 70 à 80 % des patients, et cela quel que soit leur âge ! Que s’est- il passé ? Un enchaînement de plusieurs innovations dans différents domaines tels que la biologie et la thérapeutique… Nous pouvons ainsi énumérer : le décryptage de sa physiopathologique avec la caractérisation de plusieurs voies de signalisation majeures impliquées dans sa lymphomagenèse ; plusieurs sous-types de lymphomes du manteau identifiés ; sur le plan thérapeutique, l’introduction en première ligne de l’aracytine en polychimiothérapie qui a détrôné le sacro-saint « CHOP » en première ligne pour les sujets jeunes (moins de 65 ans), l’introduction du rituximab en association à la chimiothérapie en induction, mais aussi chez les patients âgés (plus de 65 ans) en entretien, et chez les patients jeunes le traitement intensif avec greffe de cellules souches autologues. Mais surtout, c’est le premier lymphome où l’utilisation d’un inhibiteur de tyrosine kinase a montré un bénéfice majeur dans le traitement des patients en rechute ou réfractaires, et que d’autres nouveaux agents tels que les immunomodulateurs ou inhibiteurs du protéasome ont montré une efficacité. Actuellement nous en sommes donc au point de pouvoir demander plus en termes de réponse, et d’analyser les résultats thérapeutiques avec des techniques moléculaires ou d’imagerie fonctionnelle. Un grand merci à l’ensemble des rédacteurs qui ont accepté de nous rapporter ces dernières avancées dans le lymphome à cellules du manteau ! Pr Catherine THIEBLEMONT Coordinatrice du dossier. Hôpital-Saint Louis, Paris. catherine.thieblemont@aphp.fr -
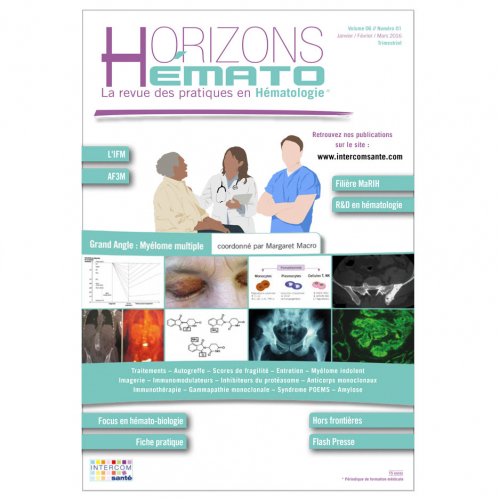 Cinq ans déjà depuis le 1er Grand Angle sur le myélome dans Horizons Hémato ! Cinq années pendant lesquelles les avancées biologiques et thérapeutiques ont été majeures pour la prise en charge des patients et cette évolution s’est concrétisée par une édition de l’ASH 2015 où le myélome a occupé une place de choix. Sur le plan biologique l’identification des sous-clones, présents dès le diagnostic et sélectionnés parfois par les traitements dans le temps et dans l’espace, a permis d’expliquer l’hétérogénéité des rechutes qui peuvent être réfractaires à toutes les nouvelles drogues mais redevenir sensibles aux « vieilles » molécules… L’hétérogénéité génétique initiale, au diagnostic, explique les profils de risque différents des patients qui peuvent rechuter rapidement et de façon explosive malgré une réponse initiale excellente. Mais c’est surtout l’évaluation de la maladie résiduelle qui a fait irruption, d’abord par la cytométrie en flux, puis par le séquençage à haut débit, plus sensible et standardisé, et qui sera utilisée pour adapter le traitement sur le plan individuel, comme dans les leucémies aiguës, lors des prochains protocoles. Les anciens critères diagnostiques du myélome ont été revisités par l’International Myeloma Working Group (IMWG) et certains myélomes indolents sont devenus des myélomes précoces, à traiter sans attendre les complications, grâce aux apports de la biologie (dosage des chaînes légères sériques) et surtout de l’imagerie. Celle-ci détrône enfin les vieilles radiographies standard au diagnostic : l’évaluation initiale doit faire appel à l’IRM corps entier et au scanner faible dose ; elle devient un élément déterminant pour l’évaluation de la maladie résiduelle extra-médullaire : le TEP-scan, comme dans les lymphomes, permet d’évaluer la réponse dont l’impact se traduit en termes de survie sans progression et de survie globale. Le traitement du sujet jeune comportera toujours une intensification, même à l’ère des nouvelles molécules, et la réponse à la question que nous nous posions en 2011 a été apportée par l’étude IFM 2009 à l’ASH 2015. Celui du sujet âgé devient plus ambitieux et associe les nouvelles drogues, si possible en un traitement tout oral ; il est aussi raisonné et doit tenir compte de la fragilité liée à l’âge et aux éventuelles comorbidités. Les nouvelles molécules ont confirmé les espoirs suscités il y a 5 ans et ont perdu pour certaines d’entre elles leur nom de code : les IMiDS font partie du quotidien (pomalidomide en rechute et lénalidomide en 1re ligne) et les nouveaux inhibiteurs du protéasome (carfilzomib et ixazomib) en feront bientôt partie, comme aux États-Unis où la FDA les a approuvés sous le nom de Kyprolis® et Ninlaro®. La nouveauté est l’irruption de l’immunothérapie dans le myélome avec l’arrivée des anticorps monoclonaux (élotuzumab et daratumumab) eux aussi approuvés par la FDA, sous le nom d’Empliciti® et Darzalex®, en cette année 2015 très faste pour le myélome. Concernant toutes ces nouvelles molécules, le plus souvent en association, la question que nous nous posions en 2011 est toujours d’actualité : serons-nous à même de prendre en charge leur coût et en offrir l’accessibilité au plus grand nombre ? Mais le myélome n’est pas l’unique maladie plasmocytaire et nous avons voulu faire figurer ici les pathologies liées aux dépôts (amylose), aux activités auto-anticorps ou à la sécrétion cytokinique (POEMS) des gammapathies monoclonales. Les gammapathies d’origine indéterminées ne le sont plus, pour certaines d’entre elles, car elles se manifestent par une atteinte rénale (gammapathie de signification rénale ou MGRS), cutanée ou neurologique qui requiert une prise en charge spécifique malgré la petite taille du clone tumoral : les MGUS deviennent des MGCS (de signification clinique). Il nous a donc semblé logique de les faire figurer dans ce Grand Angle. Enfin, et pour conclure, toutes ces avancées ont été portées en France par une activité de recherche intense, promue par l’IFM et soutenue par l’AF3M dont les présidents s’expriment ici. Alors excellente lecture et rendez-vous dans 5 ans pour répondre aux nouvelles questions sur le traitement à la carte et la guérison (enfin ?) de certains patients ! Dr Margaret MACRO Praticien Hospitalier, Institut d'Hématologie de Basse-Normandie (IHBN), CHU Caen. Liens d’intérêt : Janssen, Celgene, Novartis, Sanofi, BMS, Takeda macro-m@chu-caen.fr
Cinq ans déjà depuis le 1er Grand Angle sur le myélome dans Horizons Hémato ! Cinq années pendant lesquelles les avancées biologiques et thérapeutiques ont été majeures pour la prise en charge des patients et cette évolution s’est concrétisée par une édition de l’ASH 2015 où le myélome a occupé une place de choix. Sur le plan biologique l’identification des sous-clones, présents dès le diagnostic et sélectionnés parfois par les traitements dans le temps et dans l’espace, a permis d’expliquer l’hétérogénéité des rechutes qui peuvent être réfractaires à toutes les nouvelles drogues mais redevenir sensibles aux « vieilles » molécules… L’hétérogénéité génétique initiale, au diagnostic, explique les profils de risque différents des patients qui peuvent rechuter rapidement et de façon explosive malgré une réponse initiale excellente. Mais c’est surtout l’évaluation de la maladie résiduelle qui a fait irruption, d’abord par la cytométrie en flux, puis par le séquençage à haut débit, plus sensible et standardisé, et qui sera utilisée pour adapter le traitement sur le plan individuel, comme dans les leucémies aiguës, lors des prochains protocoles. Les anciens critères diagnostiques du myélome ont été revisités par l’International Myeloma Working Group (IMWG) et certains myélomes indolents sont devenus des myélomes précoces, à traiter sans attendre les complications, grâce aux apports de la biologie (dosage des chaînes légères sériques) et surtout de l’imagerie. Celle-ci détrône enfin les vieilles radiographies standard au diagnostic : l’évaluation initiale doit faire appel à l’IRM corps entier et au scanner faible dose ; elle devient un élément déterminant pour l’évaluation de la maladie résiduelle extra-médullaire : le TEP-scan, comme dans les lymphomes, permet d’évaluer la réponse dont l’impact se traduit en termes de survie sans progression et de survie globale. Le traitement du sujet jeune comportera toujours une intensification, même à l’ère des nouvelles molécules, et la réponse à la question que nous nous posions en 2011 a été apportée par l’étude IFM 2009 à l’ASH 2015. Celui du sujet âgé devient plus ambitieux et associe les nouvelles drogues, si possible en un traitement tout oral ; il est aussi raisonné et doit tenir compte de la fragilité liée à l’âge et aux éventuelles comorbidités. Les nouvelles molécules ont confirmé les espoirs suscités il y a 5 ans et ont perdu pour certaines d’entre elles leur nom de code : les IMiDS font partie du quotidien (pomalidomide en rechute et lénalidomide en 1re ligne) et les nouveaux inhibiteurs du protéasome (carfilzomib et ixazomib) en feront bientôt partie, comme aux États-Unis où la FDA les a approuvés sous le nom de Kyprolis® et Ninlaro®. La nouveauté est l’irruption de l’immunothérapie dans le myélome avec l’arrivée des anticorps monoclonaux (élotuzumab et daratumumab) eux aussi approuvés par la FDA, sous le nom d’Empliciti® et Darzalex®, en cette année 2015 très faste pour le myélome. Concernant toutes ces nouvelles molécules, le plus souvent en association, la question que nous nous posions en 2011 est toujours d’actualité : serons-nous à même de prendre en charge leur coût et en offrir l’accessibilité au plus grand nombre ? Mais le myélome n’est pas l’unique maladie plasmocytaire et nous avons voulu faire figurer ici les pathologies liées aux dépôts (amylose), aux activités auto-anticorps ou à la sécrétion cytokinique (POEMS) des gammapathies monoclonales. Les gammapathies d’origine indéterminées ne le sont plus, pour certaines d’entre elles, car elles se manifestent par une atteinte rénale (gammapathie de signification rénale ou MGRS), cutanée ou neurologique qui requiert une prise en charge spécifique malgré la petite taille du clone tumoral : les MGUS deviennent des MGCS (de signification clinique). Il nous a donc semblé logique de les faire figurer dans ce Grand Angle. Enfin, et pour conclure, toutes ces avancées ont été portées en France par une activité de recherche intense, promue par l’IFM et soutenue par l’AF3M dont les présidents s’expriment ici. Alors excellente lecture et rendez-vous dans 5 ans pour répondre aux nouvelles questions sur le traitement à la carte et la guérison (enfin ?) de certains patients ! Dr Margaret MACRO Praticien Hospitalier, Institut d'Hématologie de Basse-Normandie (IHBN), CHU Caen. Liens d’intérêt : Janssen, Celgene, Novartis, Sanofi, BMS, Takeda macro-m@chu-caen.fr

