-
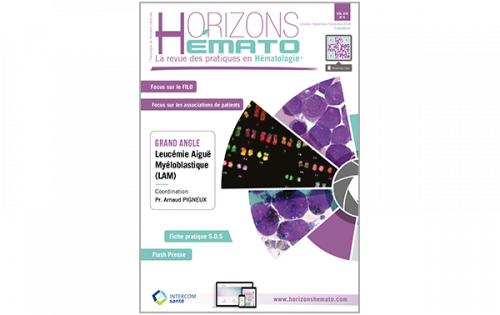 Pendant 40 ans, les progrès thérapeutiques dans le monde de la leucémie aiguë myéloblastique (LAM) ont essentiellement été obtenus par une meilleure utilisation des molécules disponibles, une meilleure gestion des soins de support et un élargissement des possibilités de réaliser des greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Nous assistons enfin maintenant à l’émergence de nouvelles molécules qui transforment le pronostic des malades atteints de ces hémopathies. La mise à disposition de ces progrès thérapeutiques se fait en partie par la coopération avec l’industrie pharmaceutique mais aussi grâce à une activité toujours plus intense de nos groupes coopératifs. Nous avons laissé le soin aux plus jeunes des membres du Conseil Scientifique LAM du groupe FILO de présenter ici certaines de ces innovations et de faire le point sur les pratiques et les recommandations concernant les LAM pour notre groupe. Les sujets abordés sont larges, allant de l’épidémiologie aux traitements différenciés des sujets jeunes ou plus âgés, de novo, en rechute ou réfractaires. Sont également présents la recherche de maladie résiduelle ici traitée par l’aspect de son évaluation en cytométrie en flux, un point sur l’allogreffe et les nouveaux médicaments ciblés anti-FLT3 anti-IDH. Un grand merci à tous les auteurs pour leurs contributions remises dans les délais et un immense merci au Professeur Marie-Christine Béné qui, telle la dentelière, avec minutie, a relu l’intégralité de ces manuscrits. Bonne lecture ! Pr Arnaud Pigneux, coordinateur du Grand angle LAM.
Pendant 40 ans, les progrès thérapeutiques dans le monde de la leucémie aiguë myéloblastique (LAM) ont essentiellement été obtenus par une meilleure utilisation des molécules disponibles, une meilleure gestion des soins de support et un élargissement des possibilités de réaliser des greffes de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Nous assistons enfin maintenant à l’émergence de nouvelles molécules qui transforment le pronostic des malades atteints de ces hémopathies. La mise à disposition de ces progrès thérapeutiques se fait en partie par la coopération avec l’industrie pharmaceutique mais aussi grâce à une activité toujours plus intense de nos groupes coopératifs. Nous avons laissé le soin aux plus jeunes des membres du Conseil Scientifique LAM du groupe FILO de présenter ici certaines de ces innovations et de faire le point sur les pratiques et les recommandations concernant les LAM pour notre groupe. Les sujets abordés sont larges, allant de l’épidémiologie aux traitements différenciés des sujets jeunes ou plus âgés, de novo, en rechute ou réfractaires. Sont également présents la recherche de maladie résiduelle ici traitée par l’aspect de son évaluation en cytométrie en flux, un point sur l’allogreffe et les nouveaux médicaments ciblés anti-FLT3 anti-IDH. Un grand merci à tous les auteurs pour leurs contributions remises dans les délais et un immense merci au Professeur Marie-Christine Béné qui, telle la dentelière, avec minutie, a relu l’intégralité de ces manuscrits. Bonne lecture ! Pr Arnaud Pigneux, coordinateur du Grand angle LAM. -
 Dans ce second volet consacré à la pathologie érythrocytaire notre « Grand Angle » se focalise sur la prise en charge actuelle des surcharges martiales et de la drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente sur le territoire français. Les syndromes thalassémiques sont abordés sous l’angle novateur de la thérapie génique, rappelant que la recherche dans ce domaine constitue une source majeure d’espoir pour les patients. La rubrique biologie quant à elle nous éclaire sur l’apport des techniques de cytogénétique moléculaire (CGH-array, SNP-array) appliquées au diagnostic des hémopathies malignes. La rédaction d’Horizons Hémato tient à remercier chaleureusement le Professeur Loïc Garçon ainsi que tous les éminents experts français ici réunis pour leur contribution à ce nouveau numéro. Bonne lecture ! Dr. Christophe Marzac. Rédacteur en chef-adjoint. Gustave Roussy, Villejuif.
Dans ce second volet consacré à la pathologie érythrocytaire notre « Grand Angle » se focalise sur la prise en charge actuelle des surcharges martiales et de la drépanocytose, maladie génétique la plus fréquente sur le territoire français. Les syndromes thalassémiques sont abordés sous l’angle novateur de la thérapie génique, rappelant que la recherche dans ce domaine constitue une source majeure d’espoir pour les patients. La rubrique biologie quant à elle nous éclaire sur l’apport des techniques de cytogénétique moléculaire (CGH-array, SNP-array) appliquées au diagnostic des hémopathies malignes. La rédaction d’Horizons Hémato tient à remercier chaleureusement le Professeur Loïc Garçon ainsi que tous les éminents experts français ici réunis pour leur contribution à ce nouveau numéro. Bonne lecture ! Dr. Christophe Marzac. Rédacteur en chef-adjoint. Gustave Roussy, Villejuif. -
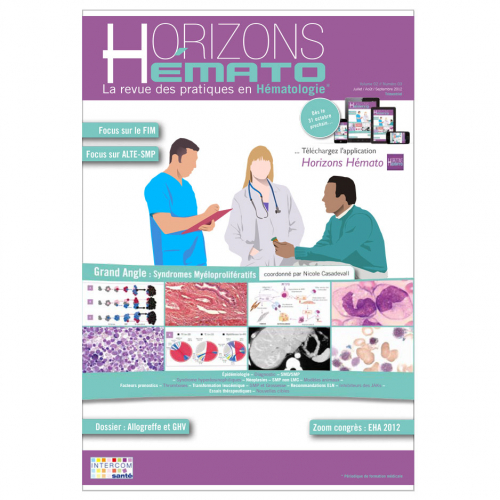 C’est en 1951 que, William Dameshek, émet l’hypothèse essentielle (TE) et la myélofibrose primaire (MFP) sont des hémopathies étroitement apparentées avec à leur origine un stimulus commun. À l'origine appelées syndromes myéloprolifératifs (SMP), elles ont été renommées néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) mais cette terminologie n'est pas adaptée à la modélisation et aux formes familiales. Pour ces raisons, cette nomenclature n'est pas adoptée de façon universelle. La description en 2005 de la mutation activatrice V617F du gène codant pour JAK2 (Janus Kinase 2), une tyrosine kinase impliquée dans la signalisation de nombreux récepteurs de cytokines dont ceux de l’érythropoïétine de la thrombopoïétine et des cytokines de la lignée granuleuse, a fourni une explication aux similitudes cliniques et évolutives de ces 3 hémopathies. En effet au moins 95 % des PV, 50 à 60 % des TE et des MFP présentent la mutation V617F. D’autres mutations plus rares ont été décrites et toutes induisent une dérégulation du signal induit par les récepteurs aux cytokines avec une activation constitutive de JAK2 et un rôle important de l’activation des STAT, dont STAT5, dans leur pathogénie. Cependant il reste à démontrer que ceci est également vrai dans les TE et les MFP sans mutation de signalisation identifiée. Cette découverte a ouvert le champ à une recherche très active, aussi bien fondamentale que clinique. Une première conséquence a été en 2008 la modification des algorithmes diagnostiques recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’intégration de la mutation V617F de JAK2 dans les critères majeurs. Un autre aspect encore incomplètement compris est comment une mutation unique (V617F) peut donner trois pathologies différentes. Il existe trois grandes hypothèses qui ne sont pas antinomiques. Dans la première c’est le niveau de signalisation voire son type qui définit la maladie. L’un des déterminants majeurs est la présence ou non d’un clone homozygote survenu à la suite d’une recombinaison mitotique du clone hétérozygote et qui entraîne une dominance clonale. Cet aspect du point de vue pratique se traduit par la charge allélique plus forte dans les MF secondaires que dans les PV et plus forte dans les PV que dans les TE. La seconde hypothèse souligne l’importancede déterminants génétiques constitutionnels qui vont intervenir dans la signalisation de V617F. Enfin ces dernières années de nombreux arguments ont été apportés en faveur de l’existence d’autres mutations acquises portant soit sur des régulateurs de l’épigénétique, soit sur des gènes impliqués dans l’épissage qui seraient responsables de l’hétérogénéité des néoplasmes myéloprolifératifs. Ceci est particulièrement bien démontré dans les myélofibroses primaires, mais beaucoup moins évident dans les PV, les TE et les myélofibroses secondaires. La découverte de ces nombreuses autres mutations non impliquées dans la signalisation a mis en évidence une plus grande complexité dans la physiopathologie des NPM qu’attendue et en font des maladies beaucoup plus complexes que la LMC. Surtout ces données font que la théorie initiale de W. Dameshek ne représente qu’une partie de la réalité et que les NPM doivent être plus vus comme une continuité avec les autres hémopathies malignes comme les SMP/SMD, les SMD voire les LAM. Cette continuité en fait donc des maladies particulièrement attractives pour comprendre l’oncogenèse des hémopathies malignes et également pour développer de nouveaux traitements. Ces cinq dernières années ont vu des changements thérapeutiques profonds basés sur l’utilisation de l’Interféron-alpha et sur des inhibiteurs de JAK2. On peut penser que ces nouvelles approches thérapeutiques n’en sont qu’à leur début et évolueront lorsqu’on progressera à la fois dans la compréhension des modifications engendrées dans la structure de JAK2 par les mutations et dans le rôle des autres mutations dans la physiopathologie de ces maladies. Nous avons essayé, dans ce numéro d’Horizons Hémato consacré aux SMP, d’aller des aspects fondamentaux à la pratique. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la rédaction de ces articles très riches et nous espérons que les lecteurs prendront conscience du vaste champ de recherche qui s’ouvre dans ces pathologies Ce numéro de la revue coïncide avec le lancement de l’application Horizons Hémato. L’ampleur des informations apportées par la totalité des articles va permettre une publication papier synthétique, enrichie par les divers compléments postés sur l’application. Nous vous souhaitons une très bonne lecture, Nicole CASADEVALL Coordinatrice du dossier SMP nicole.casadevall@sat.aphp.fr William VAINCHENKER Président du conseil scientifique du FIM verpre@igr.fr
C’est en 1951 que, William Dameshek, émet l’hypothèse essentielle (TE) et la myélofibrose primaire (MFP) sont des hémopathies étroitement apparentées avec à leur origine un stimulus commun. À l'origine appelées syndromes myéloprolifératifs (SMP), elles ont été renommées néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) mais cette terminologie n'est pas adaptée à la modélisation et aux formes familiales. Pour ces raisons, cette nomenclature n'est pas adoptée de façon universelle. La description en 2005 de la mutation activatrice V617F du gène codant pour JAK2 (Janus Kinase 2), une tyrosine kinase impliquée dans la signalisation de nombreux récepteurs de cytokines dont ceux de l’érythropoïétine de la thrombopoïétine et des cytokines de la lignée granuleuse, a fourni une explication aux similitudes cliniques et évolutives de ces 3 hémopathies. En effet au moins 95 % des PV, 50 à 60 % des TE et des MFP présentent la mutation V617F. D’autres mutations plus rares ont été décrites et toutes induisent une dérégulation du signal induit par les récepteurs aux cytokines avec une activation constitutive de JAK2 et un rôle important de l’activation des STAT, dont STAT5, dans leur pathogénie. Cependant il reste à démontrer que ceci est également vrai dans les TE et les MFP sans mutation de signalisation identifiée. Cette découverte a ouvert le champ à une recherche très active, aussi bien fondamentale que clinique. Une première conséquence a été en 2008 la modification des algorithmes diagnostiques recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’intégration de la mutation V617F de JAK2 dans les critères majeurs. Un autre aspect encore incomplètement compris est comment une mutation unique (V617F) peut donner trois pathologies différentes. Il existe trois grandes hypothèses qui ne sont pas antinomiques. Dans la première c’est le niveau de signalisation voire son type qui définit la maladie. L’un des déterminants majeurs est la présence ou non d’un clone homozygote survenu à la suite d’une recombinaison mitotique du clone hétérozygote et qui entraîne une dominance clonale. Cet aspect du point de vue pratique se traduit par la charge allélique plus forte dans les MF secondaires que dans les PV et plus forte dans les PV que dans les TE. La seconde hypothèse souligne l’importancede déterminants génétiques constitutionnels qui vont intervenir dans la signalisation de V617F. Enfin ces dernières années de nombreux arguments ont été apportés en faveur de l’existence d’autres mutations acquises portant soit sur des régulateurs de l’épigénétique, soit sur des gènes impliqués dans l’épissage qui seraient responsables de l’hétérogénéité des néoplasmes myéloprolifératifs. Ceci est particulièrement bien démontré dans les myélofibroses primaires, mais beaucoup moins évident dans les PV, les TE et les myélofibroses secondaires. La découverte de ces nombreuses autres mutations non impliquées dans la signalisation a mis en évidence une plus grande complexité dans la physiopathologie des NPM qu’attendue et en font des maladies beaucoup plus complexes que la LMC. Surtout ces données font que la théorie initiale de W. Dameshek ne représente qu’une partie de la réalité et que les NPM doivent être plus vus comme une continuité avec les autres hémopathies malignes comme les SMP/SMD, les SMD voire les LAM. Cette continuité en fait donc des maladies particulièrement attractives pour comprendre l’oncogenèse des hémopathies malignes et également pour développer de nouveaux traitements. Ces cinq dernières années ont vu des changements thérapeutiques profonds basés sur l’utilisation de l’Interféron-alpha et sur des inhibiteurs de JAK2. On peut penser que ces nouvelles approches thérapeutiques n’en sont qu’à leur début et évolueront lorsqu’on progressera à la fois dans la compréhension des modifications engendrées dans la structure de JAK2 par les mutations et dans le rôle des autres mutations dans la physiopathologie de ces maladies. Nous avons essayé, dans ce numéro d’Horizons Hémato consacré aux SMP, d’aller des aspects fondamentaux à la pratique. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la rédaction de ces articles très riches et nous espérons que les lecteurs prendront conscience du vaste champ de recherche qui s’ouvre dans ces pathologies Ce numéro de la revue coïncide avec le lancement de l’application Horizons Hémato. L’ampleur des informations apportées par la totalité des articles va permettre une publication papier synthétique, enrichie par les divers compléments postés sur l’application. Nous vous souhaitons une très bonne lecture, Nicole CASADEVALL Coordinatrice du dossier SMP nicole.casadevall@sat.aphp.fr William VAINCHENKER Président du conseil scientifique du FIM verpre@igr.fr -
 Les pathologies hémorragiques constitutionnelles de l’hémostase sont rares, mais variées. Au-delà des aspects diagnostiques partant de la symptomatologie commune mais très polymorphe qu’est le syndrome hémorragique, elles ouvrent des champs très divers. Compte tenu de l’histoire, ces pathologies sont rarement prises en charge directement dans les services d’hématologie clinique et les centres de traitement de maladies hémorragiques sont le plus souvent rattachés à des laboratoires spécialisés en hémostase, mais aussi à des services de pédiatrie, de médecine interne… Un laboratoire d’hématologie biologique, et plus spécifiquement de biologie spécialisée de l’hémostase, reste la colonne vertébrale indispensable à toute structure de prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces maladies. L’hémostase clinique est en effet le prototype d’une discipline transversale clinico-biologique, où la séparation entre clinique et biologique est artificielle et dénuée se sens. Nous avons voulu dans ce numéro, donner un aperçu des différentes problématiques et faire apparaître la diversité clinique, biologique, génétique, diagnostique de ces pathologies. L’arrivée de technologies nouvelles, biologiques, génétiques, thérapeutiques, la modification phénotypique qu’on peut attendre de la présentation de la maladie, liée aux modifications des stratégies thérapeutiques de l’hémophilie au cours des deux dernières décennies vont certainement bouleverser les approches dans les 5 à 10 ans à venir. La situation décrite est celle de 2015, dans une spécialité qui constitue donc une niche en pleine évolution dans le monde de l’hématologie. Enfin, un grand merci à tous les auteurs qui, chacun sousun angle particulier, ont accepté de participer à ce numéro. Thierry LAMBERT Coordinateur du Grand Format « hémophilie et maladies hémorragiques constitutionnelles ». Centre de Référence pour le Traitement des Hémophiles, Le Kremlin-Bicêtre. thierry.lambert@aphp.fr
Les pathologies hémorragiques constitutionnelles de l’hémostase sont rares, mais variées. Au-delà des aspects diagnostiques partant de la symptomatologie commune mais très polymorphe qu’est le syndrome hémorragique, elles ouvrent des champs très divers. Compte tenu de l’histoire, ces pathologies sont rarement prises en charge directement dans les services d’hématologie clinique et les centres de traitement de maladies hémorragiques sont le plus souvent rattachés à des laboratoires spécialisés en hémostase, mais aussi à des services de pédiatrie, de médecine interne… Un laboratoire d’hématologie biologique, et plus spécifiquement de biologie spécialisée de l’hémostase, reste la colonne vertébrale indispensable à toute structure de prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces maladies. L’hémostase clinique est en effet le prototype d’une discipline transversale clinico-biologique, où la séparation entre clinique et biologique est artificielle et dénuée se sens. Nous avons voulu dans ce numéro, donner un aperçu des différentes problématiques et faire apparaître la diversité clinique, biologique, génétique, diagnostique de ces pathologies. L’arrivée de technologies nouvelles, biologiques, génétiques, thérapeutiques, la modification phénotypique qu’on peut attendre de la présentation de la maladie, liée aux modifications des stratégies thérapeutiques de l’hémophilie au cours des deux dernières décennies vont certainement bouleverser les approches dans les 5 à 10 ans à venir. La situation décrite est celle de 2015, dans une spécialité qui constitue donc une niche en pleine évolution dans le monde de l’hématologie. Enfin, un grand merci à tous les auteurs qui, chacun sousun angle particulier, ont accepté de participer à ce numéro. Thierry LAMBERT Coordinateur du Grand Format « hémophilie et maladies hémorragiques constitutionnelles ». Centre de Référence pour le Traitement des Hémophiles, Le Kremlin-Bicêtre. thierry.lambert@aphp.fr -
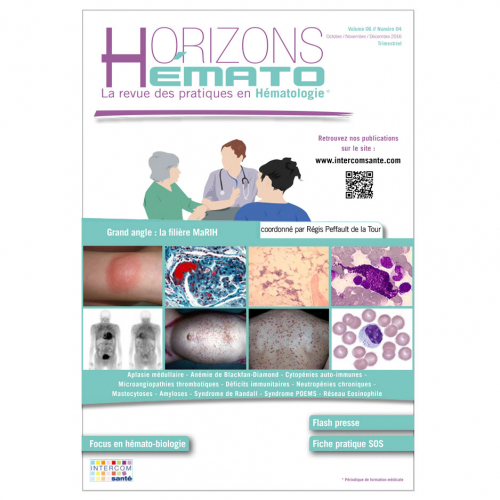 La maladie rare est définie par une prévalence de 1 sur 2 000. En France, ces maladies touchent plus de 3 millions de personnes avec plus de 8 000 maladies identifiées à ce jour. La France est un leader européen de par son engagement pour l’amélioration de la prise en charge de ces maladies. Sous l’impulsion du Ministère de la santé, deux plans nationaux maladies rares « PNMR » ont d’ores et déjà étaient mis en place : Le PNMR 1 2005-2008 a labellisé 131 centres de référence maladies rares « CRMR » associés à 501 centres de compétences « CCMR » permettant d’assurer la prise en charge et le suivi des patients au plus proche de leur domicile, en lien avec les associations de patients. Les CRMR ont 5 missions : - la coordination et l’animation de son réseau en organisant entre autre des journées nationales scientifiques ; - l’expertise clinique à travers des réunions de concertation pluridisciplinaire « RCP », l’élaboration de recommandations et de protocoles nationaux de diagnostic et de soins « PNDS » et le recueil épidémiologique ; - le recours en assurant une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle diagnostique, thérapeutique et de suivi ; - la recherche translationnelle, clinique ou organisationnelle contribuant à la reconnaissance de son expertise ; - l’enseignement et la formation des professionnels de la santé. Le PNMR 2 2011-2014, prolongé jusqu’en 2016, a renforcé les liens entre les différents acteurs de la prise en charge en les intégrant dans un seul et même réseau, sur un champ large et cohérent de maladies rares soit proches dans leurs manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte d’un même organe ou système. Ces réseaux, appelés filières de santé maladies rares « FSMR » ont pour missions d’animer et de coordonner les actions entre CRMR, CCMR, laboratoires de recherche et/ou diagnostic et associations de patients en partenariat avec les sociétés savantes afin d’instaurer des synergies sur des problématiques transversales (amélioration du soin, développement de la recherche, la communication et la formation). En 2014, 23 FSMR ont été labellisées par le Ministère de la santé, dont MaRIH pour les maladies rares immuno-hématologiques. Un troisième plan est actuellement en cours d’élaboration afin de consolider les efforts entrepris par ces deux premiers et un nouvel appel à projets visant la relabellisation ou la création de nouveaux CRMR est ouverte aux candidatures jusqu’au 26 janvier 2017. Au travers de ces différents plans, la France reste un leader européen de la prise en charge des maladies rares. Récemment, les réseaux européens maladies rares créés l’ont été sur le modèle des filières de santé illustrant une nouvelle fois le rôle innovant de notre pays dans ce domaine. La filière de santé maladie rare MaRIH regroupe 12 centres de références qui postulent tous à leur relabélisation et appartient au réseau EuroBloodNet récemment créé, l’ensemble permettant d’apporter à nos patients une prise en charge clinique de tout premier plan, une recherche de grande qualité et une formation des plus jeunes que beaucoup nous envie. Bonne lecture à tous ! Régis PEFFAULT DE LA TOUR Coordinateur du Grand Angle "La filière MaRiH" Hôpital Saint- Louis, AP-HP, Paris. regis.peffaultdelatour@aphp.fr
La maladie rare est définie par une prévalence de 1 sur 2 000. En France, ces maladies touchent plus de 3 millions de personnes avec plus de 8 000 maladies identifiées à ce jour. La France est un leader européen de par son engagement pour l’amélioration de la prise en charge de ces maladies. Sous l’impulsion du Ministère de la santé, deux plans nationaux maladies rares « PNMR » ont d’ores et déjà étaient mis en place : Le PNMR 1 2005-2008 a labellisé 131 centres de référence maladies rares « CRMR » associés à 501 centres de compétences « CCMR » permettant d’assurer la prise en charge et le suivi des patients au plus proche de leur domicile, en lien avec les associations de patients. Les CRMR ont 5 missions : - la coordination et l’animation de son réseau en organisant entre autre des journées nationales scientifiques ; - l’expertise clinique à travers des réunions de concertation pluridisciplinaire « RCP », l’élaboration de recommandations et de protocoles nationaux de diagnostic et de soins « PNDS » et le recueil épidémiologique ; - le recours en assurant une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle diagnostique, thérapeutique et de suivi ; - la recherche translationnelle, clinique ou organisationnelle contribuant à la reconnaissance de son expertise ; - l’enseignement et la formation des professionnels de la santé. Le PNMR 2 2011-2014, prolongé jusqu’en 2016, a renforcé les liens entre les différents acteurs de la prise en charge en les intégrant dans un seul et même réseau, sur un champ large et cohérent de maladies rares soit proches dans leurs manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte d’un même organe ou système. Ces réseaux, appelés filières de santé maladies rares « FSMR » ont pour missions d’animer et de coordonner les actions entre CRMR, CCMR, laboratoires de recherche et/ou diagnostic et associations de patients en partenariat avec les sociétés savantes afin d’instaurer des synergies sur des problématiques transversales (amélioration du soin, développement de la recherche, la communication et la formation). En 2014, 23 FSMR ont été labellisées par le Ministère de la santé, dont MaRIH pour les maladies rares immuno-hématologiques. Un troisième plan est actuellement en cours d’élaboration afin de consolider les efforts entrepris par ces deux premiers et un nouvel appel à projets visant la relabellisation ou la création de nouveaux CRMR est ouverte aux candidatures jusqu’au 26 janvier 2017. Au travers de ces différents plans, la France reste un leader européen de la prise en charge des maladies rares. Récemment, les réseaux européens maladies rares créés l’ont été sur le modèle des filières de santé illustrant une nouvelle fois le rôle innovant de notre pays dans ce domaine. La filière de santé maladie rare MaRIH regroupe 12 centres de références qui postulent tous à leur relabélisation et appartient au réseau EuroBloodNet récemment créé, l’ensemble permettant d’apporter à nos patients une prise en charge clinique de tout premier plan, une recherche de grande qualité et une formation des plus jeunes que beaucoup nous envie. Bonne lecture à tous ! Régis PEFFAULT DE LA TOUR Coordinateur du Grand Angle "La filière MaRiH" Hôpital Saint- Louis, AP-HP, Paris. regis.peffaultdelatour@aphp.fr -
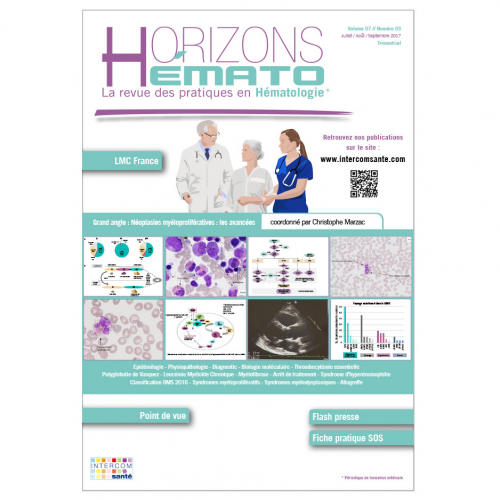 Les Néoplasmes Myéloprolifératifs : un paradigme de la médecine de précision. Il y a cinq ans nous vous proposions un numéro très détaillé consacré aux syndromes myéloprolifératifs (SMP) désormais dénommés Néoplasmes MyéloProlifératifs (NMP). À l’époque nos esprits résonnaient encore de la découverte des mutations de JAK2, MPL puis de TET2 dans les SMP dits « classiques » ou encore de l’apparition des inhibiteurs de tyrosine kinase de seconde génération et des premiers essais d’arrêt de traitement dans la leucémie myéloïde chronique. Depuis lors les connaissances se sont encore enrichies donnant naissance à une nouvelle version de la classification OMS qui intègre toujours plus de critères histologiques et de données génétiques (mutations des gènes de la calréticuline, des protéines des complexes d’épissages, des régulateurs épigénétiques, découverte de nouveaux gènes de prédisposition). Cette nouvelle classification qui revisite jusqu’à la définition même de la polyglobulie de Vaquez permet aussi de mieux préciser les contours parfois flous dans nos esprits des néoplasies mixtes myélodysplasiques/myéloprolifératives. Les laboratoires de biologie moléculaire ont un rôle déterminant dans la caractérisation de ces hémopathies myéloïdes chroniques dont nous commençons à entrevoir la réelle complexité grâce notamment à l’étude ciblée de panels de gènes. Certains de ces gènes mutés constituent d’ores-et-déjà des cibles thérapeutiques « actionnables » (JAK2, CALR, CSF3R, KIT,..), d’autres le deviendront rapidement (IDH1/2, splicéosome), rappelant l’intérêt majeur des essais thérapeutiques dans l’amélioration continue du pronostic de ces hémopathies pour lesquelles les données épidémiologiques font parfois cruellement défaut. [...] Bonne lecture ! Dr Christophe Marzac Coordinateur du "Grand Angle" Rédacteur en chef adjoint christophe.marzac@gustaveroussy.fr
Les Néoplasmes Myéloprolifératifs : un paradigme de la médecine de précision. Il y a cinq ans nous vous proposions un numéro très détaillé consacré aux syndromes myéloprolifératifs (SMP) désormais dénommés Néoplasmes MyéloProlifératifs (NMP). À l’époque nos esprits résonnaient encore de la découverte des mutations de JAK2, MPL puis de TET2 dans les SMP dits « classiques » ou encore de l’apparition des inhibiteurs de tyrosine kinase de seconde génération et des premiers essais d’arrêt de traitement dans la leucémie myéloïde chronique. Depuis lors les connaissances se sont encore enrichies donnant naissance à une nouvelle version de la classification OMS qui intègre toujours plus de critères histologiques et de données génétiques (mutations des gènes de la calréticuline, des protéines des complexes d’épissages, des régulateurs épigénétiques, découverte de nouveaux gènes de prédisposition). Cette nouvelle classification qui revisite jusqu’à la définition même de la polyglobulie de Vaquez permet aussi de mieux préciser les contours parfois flous dans nos esprits des néoplasies mixtes myélodysplasiques/myéloprolifératives. Les laboratoires de biologie moléculaire ont un rôle déterminant dans la caractérisation de ces hémopathies myéloïdes chroniques dont nous commençons à entrevoir la réelle complexité grâce notamment à l’étude ciblée de panels de gènes. Certains de ces gènes mutés constituent d’ores-et-déjà des cibles thérapeutiques « actionnables » (JAK2, CALR, CSF3R, KIT,..), d’autres le deviendront rapidement (IDH1/2, splicéosome), rappelant l’intérêt majeur des essais thérapeutiques dans l’amélioration continue du pronostic de ces hémopathies pour lesquelles les données épidémiologiques font parfois cruellement défaut. [...] Bonne lecture ! Dr Christophe Marzac Coordinateur du "Grand Angle" Rédacteur en chef adjoint christophe.marzac@gustaveroussy.fr -
 Nous avons le plaisir de vous présenter ce deuxième volume du dossier « Grand Angle » consacré au myélome multiple. Après un premier volet centré sur la physiopathologie et la prise en charge initiale, ce numéro met en lumière les formes particulières de la maladie et fait le point sur les avancées récentes en immunothérapie de nouvelle génération. Vous y trouverez tout d’abord un focus sur les expositions professionnelles, enjeu croissant de santé publique et de reconnaissance médico-sociale, ainsi que des fiches pratiques dédiées à la prise en charge du myélome à haut risque cytogénétique et des plasmocytomes solitaires. La seconde partie de ce dossier est consacrée aux immunothérapies, désormais incontournables dans la prise en charge des rechutes. Deux fiches détaillent l’actualité des anticorps bispécifiques et des cellules CAR T, ainsi que les perspectives d’amélioration des CAR T ainsi que le développement des anticorps tri-spécifiques. Nous abordons également la situation complexe des rechutes post-immunothérapie, et deux chapitres sont consacrés aux mécanismes de résistance - perte de cible et épuisement du compartiment T. Nous espérons que ce second volet enrichira votre pratique et nourrira vos réflexions. Nos remerciements vont une nouvelle fois aux auteurs pour la qualité de leurs contributions. Bonne lecture ! Pr Salomon MANIER, Lille. Coordinateur du "Grand Angle"
Nous avons le plaisir de vous présenter ce deuxième volume du dossier « Grand Angle » consacré au myélome multiple. Après un premier volet centré sur la physiopathologie et la prise en charge initiale, ce numéro met en lumière les formes particulières de la maladie et fait le point sur les avancées récentes en immunothérapie de nouvelle génération. Vous y trouverez tout d’abord un focus sur les expositions professionnelles, enjeu croissant de santé publique et de reconnaissance médico-sociale, ainsi que des fiches pratiques dédiées à la prise en charge du myélome à haut risque cytogénétique et des plasmocytomes solitaires. La seconde partie de ce dossier est consacrée aux immunothérapies, désormais incontournables dans la prise en charge des rechutes. Deux fiches détaillent l’actualité des anticorps bispécifiques et des cellules CAR T, ainsi que les perspectives d’amélioration des CAR T ainsi que le développement des anticorps tri-spécifiques. Nous abordons également la situation complexe des rechutes post-immunothérapie, et deux chapitres sont consacrés aux mécanismes de résistance - perte de cible et épuisement du compartiment T. Nous espérons que ce second volet enrichira votre pratique et nourrira vos réflexions. Nos remerciements vont une nouvelle fois aux auteurs pour la qualité de leurs contributions. Bonne lecture ! Pr Salomon MANIER, Lille. Coordinateur du "Grand Angle" -
 Après plusieurs décennies de stagnation, l’innovation dans le traitement de la LLC n’a de cesse de progresser depuis dix ans. La place de la traditionnelle immunochimiothérapie est devenue marginale dans les pays ayant accès aux thérapies ciblées et le pronostic global de la maladie s’est significativement amélioré. Le dossier actuel, rédigé par d’excellents spécialistes - Thérèse Aurran-Schleinitz, Christina Bagacéan, Romain Guièze, Grégory Lazarian, Rémi Letestu, Anne-Sophie Michallet, Loïc Ysebaert – tous membres du groupe coopérateur national FILO, couvre les principaux domaines dans lesquels une actualisation des connaissances nous a semblé nécessaire. La prise en charge en première ligne a encore évolué depuis le dernier dossier et devrait encore se modifier dans les années à venir, comme en témoigne le nombre de nouveaux médicaments et stratégies actuellement testés. La maladie résiduelle est un paramètre dont l’importance va croissante dans les essais cliniques et peut-être un jour dans la pratique courante. La recherche des mutations de résistance aux thérapies ciblées prend elle aussi une place croissante avec la généralisation de ces traitements tant en première ligne qu’au-delà. Enfin, les patients que nous prenons en charges sont souvent âgés et présentent des comorbidités importantes ; la prévention du risque infectieux-cause de mortalité majeure- est un enjeu important qui doit être adapté si nécessaire aux stratégies thérapeutiques. Il reste, dans le domaine thérapeutique, deux domaines dans lesquels les progrès se font attendre : (i) les complications dysimmunitaires et surtout (ii) le lymphome de Richter pour lequel nous espérons que les nouvelles molécules voire les traitements innovants des lymphomes permettrons d’améliorer le pronostic qui reste malheureusement dramatiquement sombre. Nous vous souhaitons à toutes et tous une agréable lecture. Pr Vincent LÉVY, Bobigny. Coordinateur du "Grand Angle"
Après plusieurs décennies de stagnation, l’innovation dans le traitement de la LLC n’a de cesse de progresser depuis dix ans. La place de la traditionnelle immunochimiothérapie est devenue marginale dans les pays ayant accès aux thérapies ciblées et le pronostic global de la maladie s’est significativement amélioré. Le dossier actuel, rédigé par d’excellents spécialistes - Thérèse Aurran-Schleinitz, Christina Bagacéan, Romain Guièze, Grégory Lazarian, Rémi Letestu, Anne-Sophie Michallet, Loïc Ysebaert – tous membres du groupe coopérateur national FILO, couvre les principaux domaines dans lesquels une actualisation des connaissances nous a semblé nécessaire. La prise en charge en première ligne a encore évolué depuis le dernier dossier et devrait encore se modifier dans les années à venir, comme en témoigne le nombre de nouveaux médicaments et stratégies actuellement testés. La maladie résiduelle est un paramètre dont l’importance va croissante dans les essais cliniques et peut-être un jour dans la pratique courante. La recherche des mutations de résistance aux thérapies ciblées prend elle aussi une place croissante avec la généralisation de ces traitements tant en première ligne qu’au-delà. Enfin, les patients que nous prenons en charges sont souvent âgés et présentent des comorbidités importantes ; la prévention du risque infectieux-cause de mortalité majeure- est un enjeu important qui doit être adapté si nécessaire aux stratégies thérapeutiques. Il reste, dans le domaine thérapeutique, deux domaines dans lesquels les progrès se font attendre : (i) les complications dysimmunitaires et surtout (ii) le lymphome de Richter pour lequel nous espérons que les nouvelles molécules voire les traitements innovants des lymphomes permettrons d’améliorer le pronostic qui reste malheureusement dramatiquement sombre. Nous vous souhaitons à toutes et tous une agréable lecture. Pr Vincent LÉVY, Bobigny. Coordinateur du "Grand Angle" -
 À l’ère d’innovations thérapeutiques sans précédent dans les lymphomes, avec des traitements si efficaces qu’il nous ait permis de penser à la guérison de nombreux patients, même en situation de rechute, l’après-cancer est un enjeu majeur, tant au niveau de sa prise en charge que de son organisation. Nous avons réuni, pour ce « Grand Angle », les réflexions de plusieurs horizons. Tout d’abord, l’article de l’équipe de Toulouse avec Mme Gisèle Compaci, infirmière-coordinatrice dont la présentation n’est plus à faire, tant son travail débuté avec le Pr. Guy Laurent a été reconnu comme la première pierre posée dans l’organisation de l’après-lymphome en France, avec un modèle de suivi partagé entre le médecin généraliste, l’hématologue et l’infirmière coordonnatrice. Le rôle de l’infirmier dans le nouveau parcours de soin de l’après-CAR T cells est décrit de manière très précise par Mr Maxime Berquier, infirmier-coordinateur à l’Hôpital Saint-Louis, avec une expérience partagée et discutée au sein du réseau national des infirmiers-coordinateurs CART. Qu’en est-il des recommandations par grandes pathologies, le lymphome de Hodgkin, les lymphomes agressifs, les lymphomes indolents? Le suivi du lymphome de hodgkin a été un modèle car depuis longtemps plus de 80% des patients sont guéris, et la surveillance de la survenue des effets secondaires doit être minutieusement réalisée comme nous l’explique le Dr Cédric Rossi et le Pr Olivier Casasnovas. Alors que l’imagerie n’a pas de place dans le suivi des lymphomes agressifs d’autant que les examens répétés ont prouvé être anxiogènes, le Dr Vincent Camus et le Pr Hervé Tilly discutent de l’analyse de l’ADN circulant qui pourrait permettre d’aider à ce suivi. Le suivi des lymphomes indolents est complexe, et occupe beaucoup nos consultations. Le Pr Ysebaert nous explique comment le réaliser de façon la plus rationnelle possible. Enfin, nous terminerons par les symptômes difficilement quantifiables, tels que la fatigue qui peut persister pendant même 10 ans après la fin du traitement comme nous l’explique de Pr Nicolas Mounier. Est-ce que des outils digitaux pourront aider à l’avenir à la prise en compte de la qualité de vie, de la fatigue, de la douleur dans la période de l’après-cancer? Le Dr Côme Bommier nous explique qu’il est désormais possible d’évaluer les patients à distance grâce à des applications de santé connectées et que cela sera possible. Un grand merci aux auteurs pour leur contribution à ce « Grand Angle » dédié à l’Après-Cancer dans le lymphome. Bonne lecture ! Pr Catherine Thieblemont, Coordinatrice du « Grand Angle ». Chef de service d’hémato-oncologie, Hôpital Saint-Louis, Paris. catherine.thieblemont@aphp.fr
À l’ère d’innovations thérapeutiques sans précédent dans les lymphomes, avec des traitements si efficaces qu’il nous ait permis de penser à la guérison de nombreux patients, même en situation de rechute, l’après-cancer est un enjeu majeur, tant au niveau de sa prise en charge que de son organisation. Nous avons réuni, pour ce « Grand Angle », les réflexions de plusieurs horizons. Tout d’abord, l’article de l’équipe de Toulouse avec Mme Gisèle Compaci, infirmière-coordinatrice dont la présentation n’est plus à faire, tant son travail débuté avec le Pr. Guy Laurent a été reconnu comme la première pierre posée dans l’organisation de l’après-lymphome en France, avec un modèle de suivi partagé entre le médecin généraliste, l’hématologue et l’infirmière coordonnatrice. Le rôle de l’infirmier dans le nouveau parcours de soin de l’après-CAR T cells est décrit de manière très précise par Mr Maxime Berquier, infirmier-coordinateur à l’Hôpital Saint-Louis, avec une expérience partagée et discutée au sein du réseau national des infirmiers-coordinateurs CART. Qu’en est-il des recommandations par grandes pathologies, le lymphome de Hodgkin, les lymphomes agressifs, les lymphomes indolents? Le suivi du lymphome de hodgkin a été un modèle car depuis longtemps plus de 80% des patients sont guéris, et la surveillance de la survenue des effets secondaires doit être minutieusement réalisée comme nous l’explique le Dr Cédric Rossi et le Pr Olivier Casasnovas. Alors que l’imagerie n’a pas de place dans le suivi des lymphomes agressifs d’autant que les examens répétés ont prouvé être anxiogènes, le Dr Vincent Camus et le Pr Hervé Tilly discutent de l’analyse de l’ADN circulant qui pourrait permettre d’aider à ce suivi. Le suivi des lymphomes indolents est complexe, et occupe beaucoup nos consultations. Le Pr Ysebaert nous explique comment le réaliser de façon la plus rationnelle possible. Enfin, nous terminerons par les symptômes difficilement quantifiables, tels que la fatigue qui peut persister pendant même 10 ans après la fin du traitement comme nous l’explique de Pr Nicolas Mounier. Est-ce que des outils digitaux pourront aider à l’avenir à la prise en compte de la qualité de vie, de la fatigue, de la douleur dans la période de l’après-cancer? Le Dr Côme Bommier nous explique qu’il est désormais possible d’évaluer les patients à distance grâce à des applications de santé connectées et que cela sera possible. Un grand merci aux auteurs pour leur contribution à ce « Grand Angle » dédié à l’Après-Cancer dans le lymphome. Bonne lecture ! Pr Catherine Thieblemont, Coordinatrice du « Grand Angle ». Chef de service d’hémato-oncologie, Hôpital Saint-Louis, Paris. catherine.thieblemont@aphp.fr

